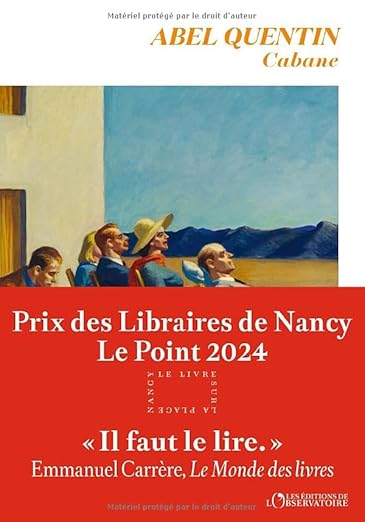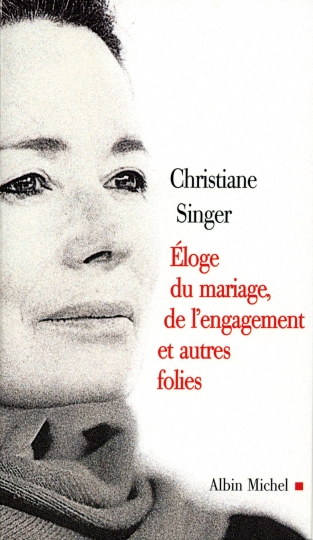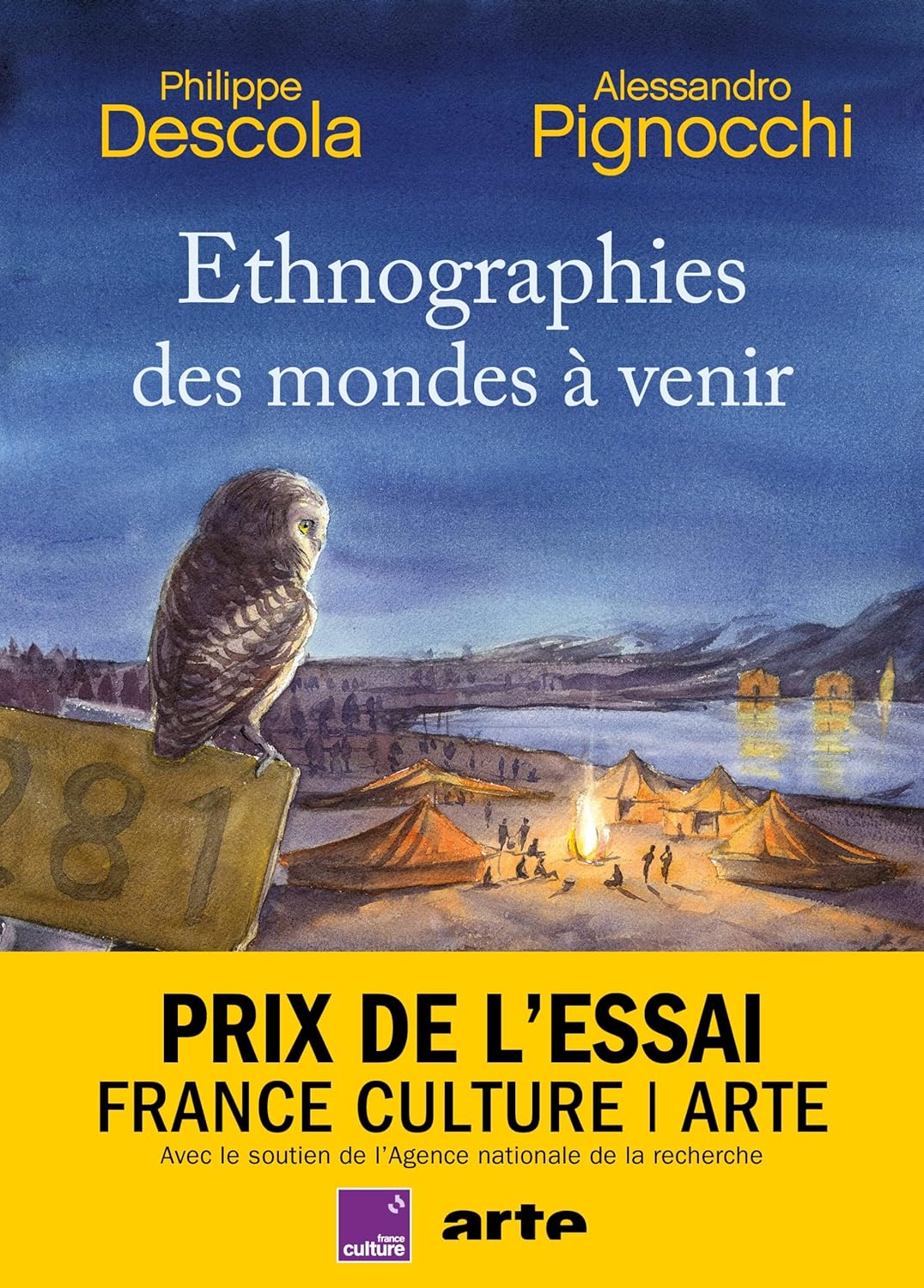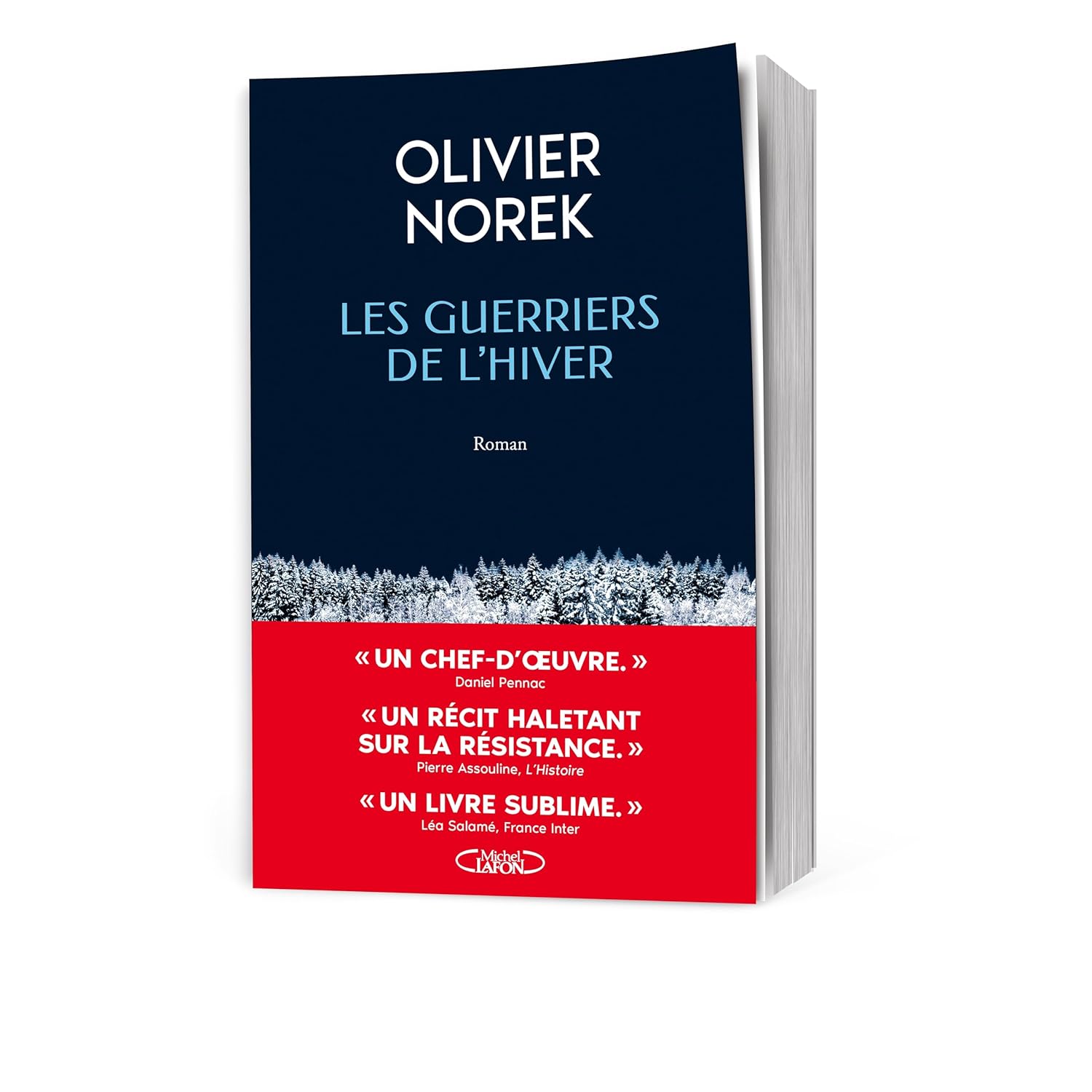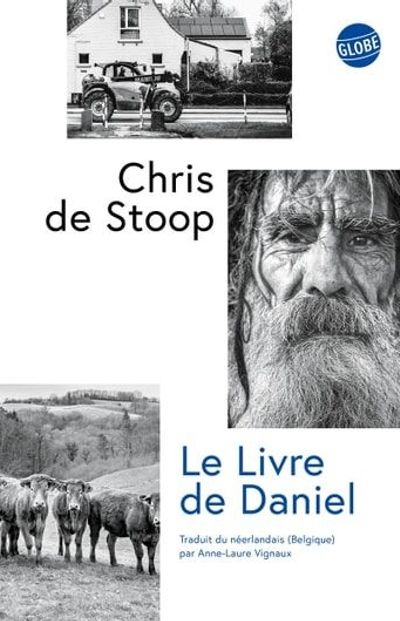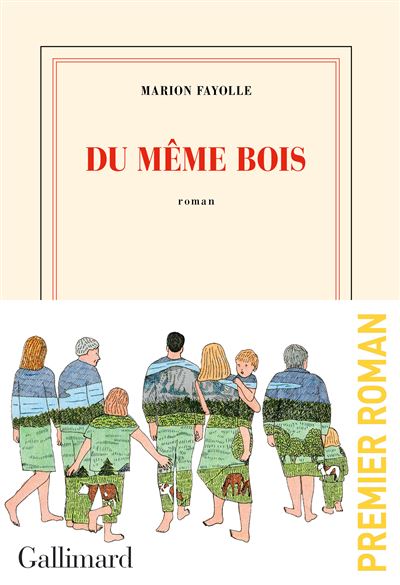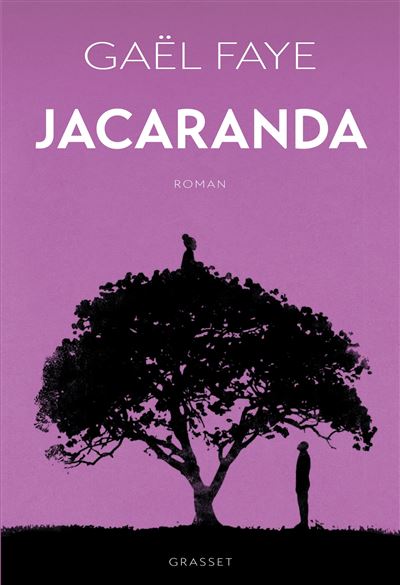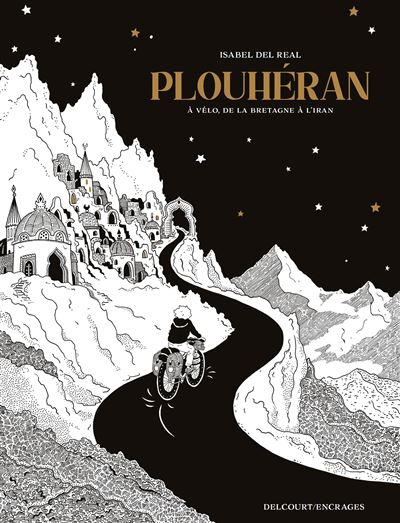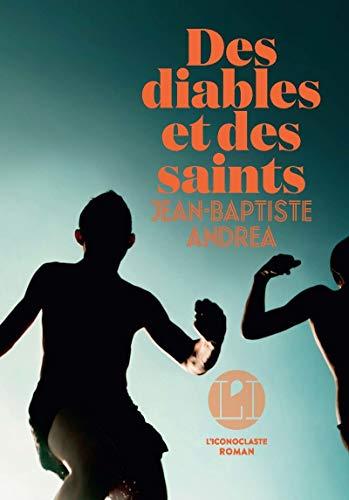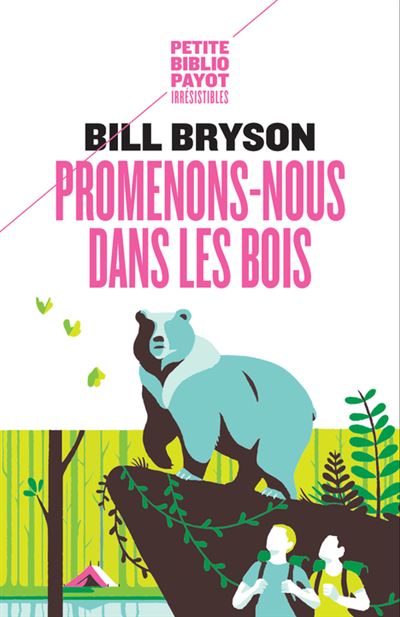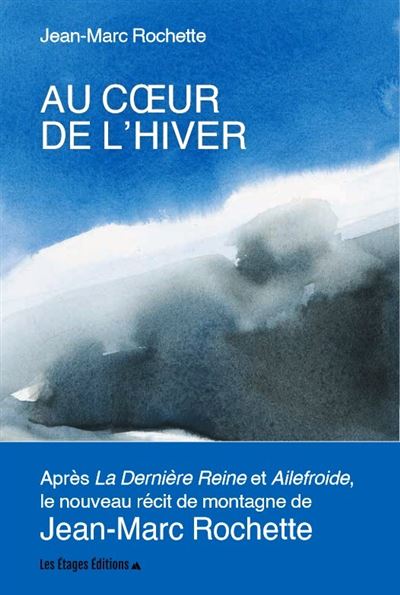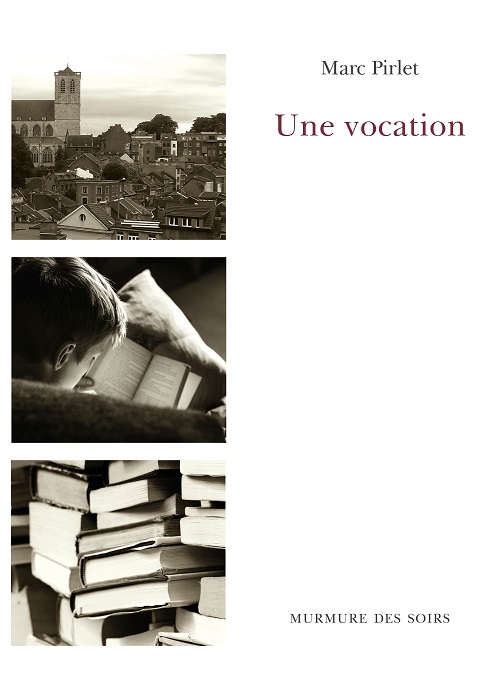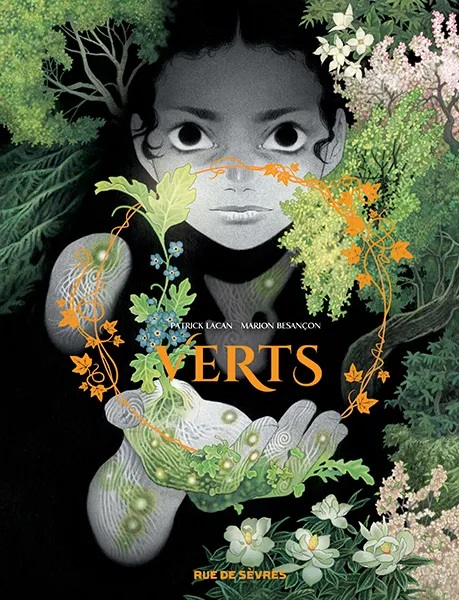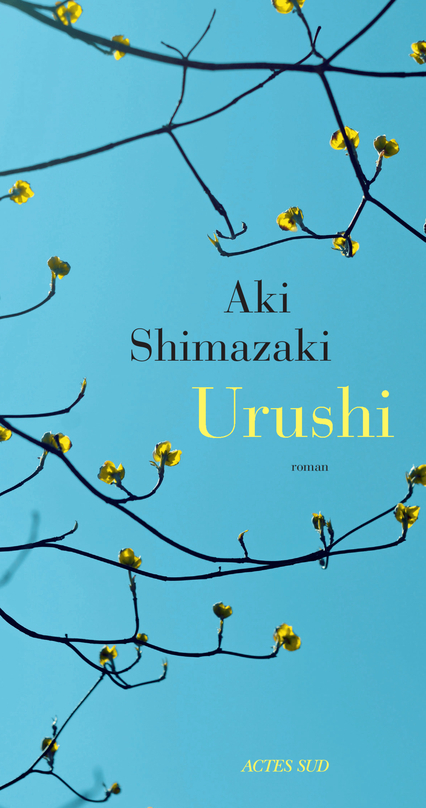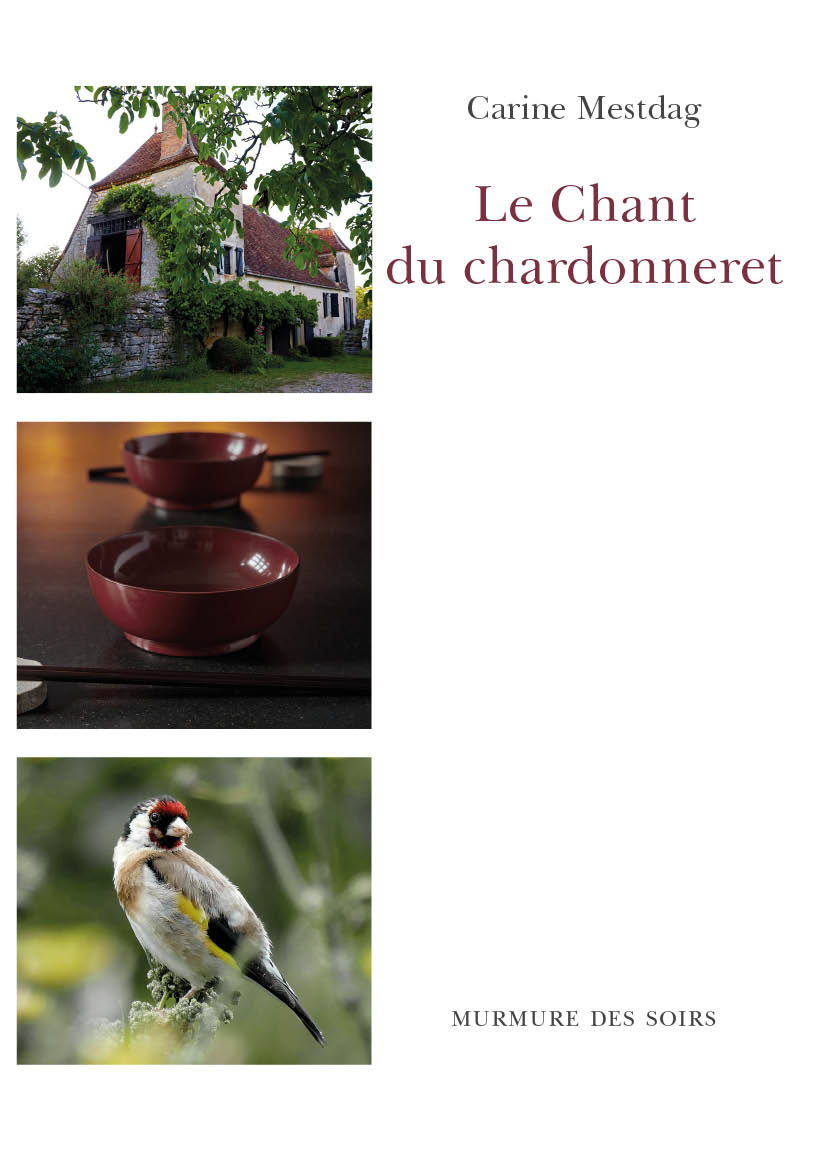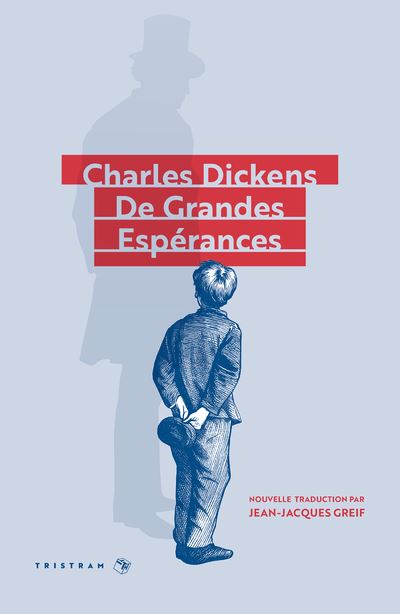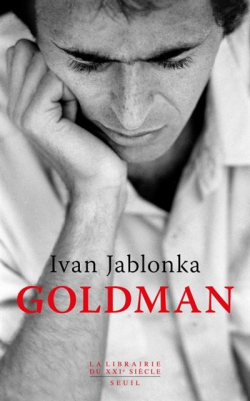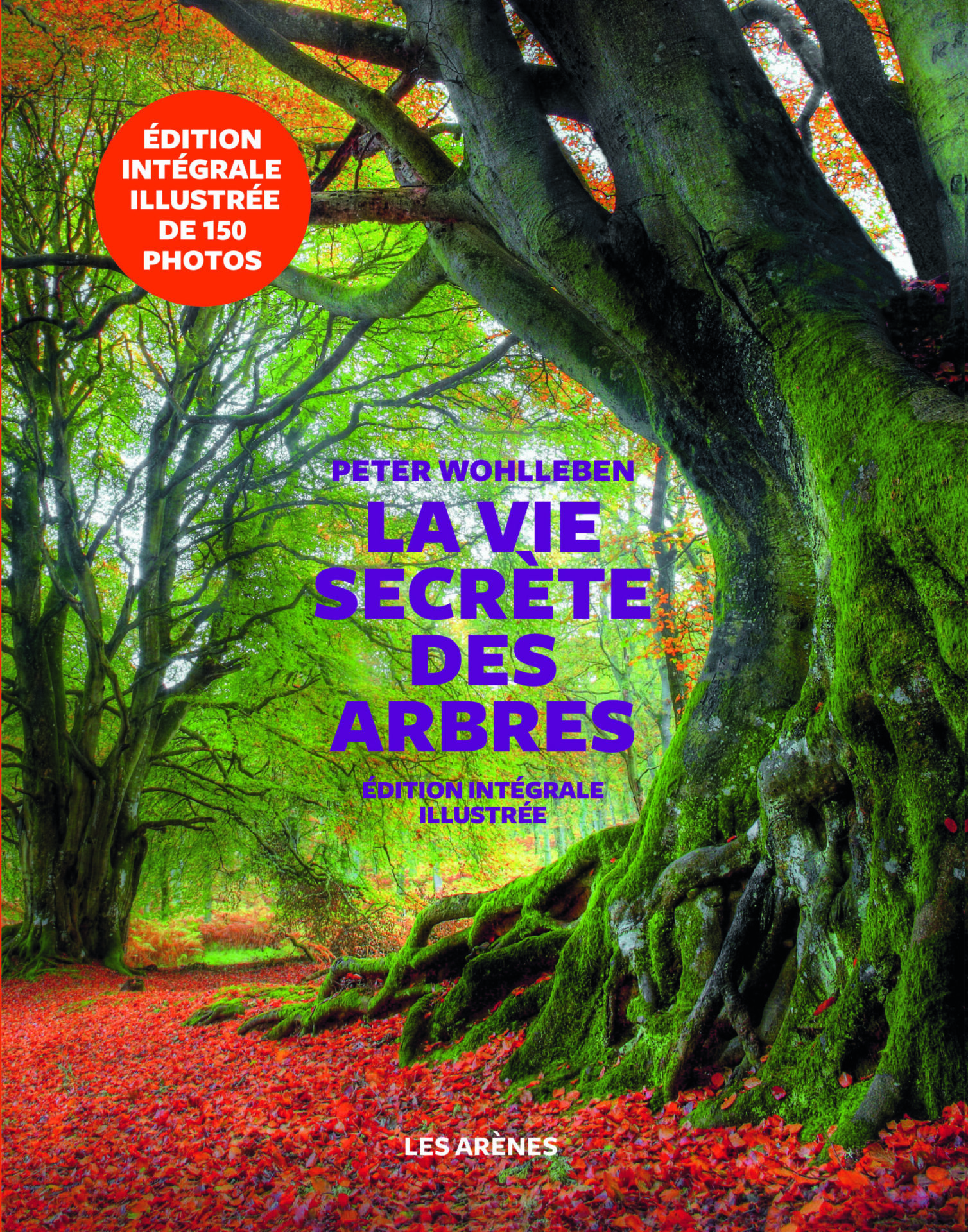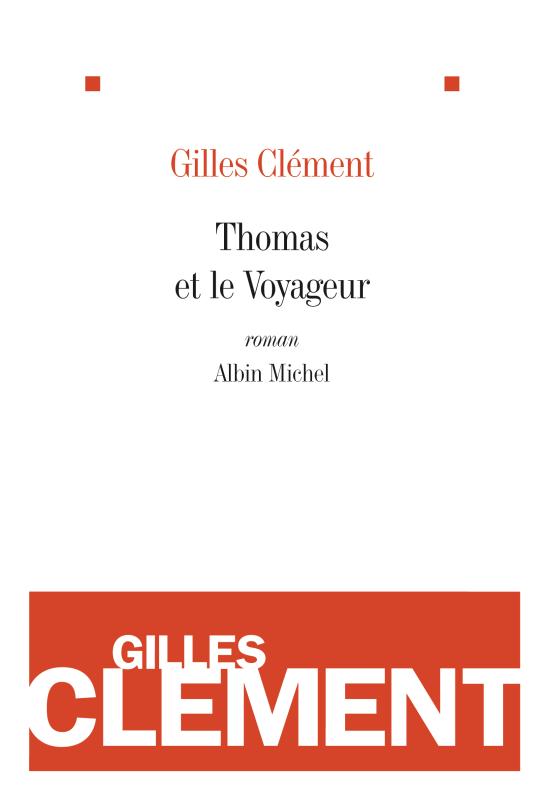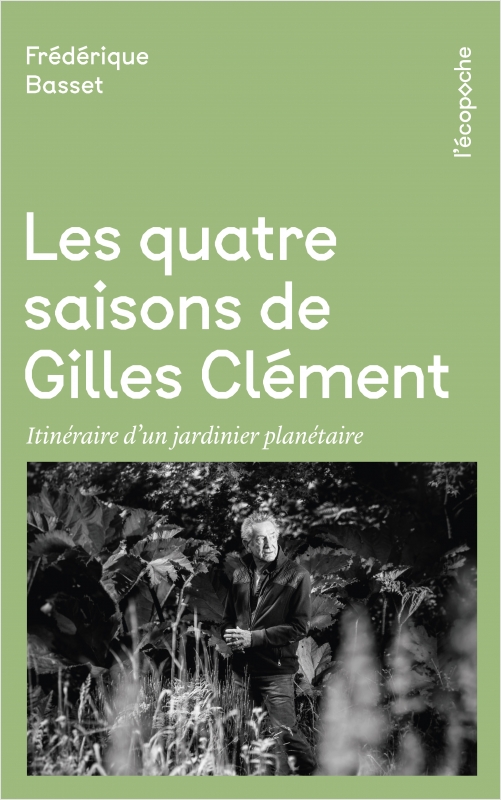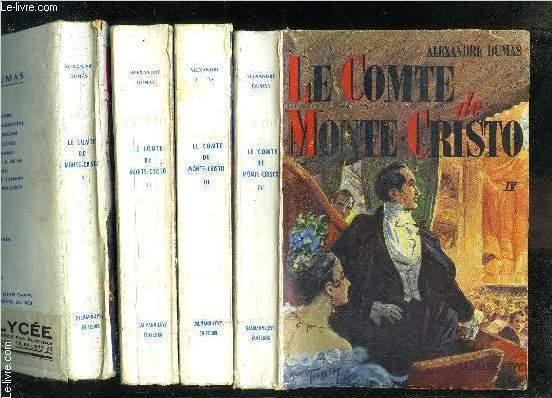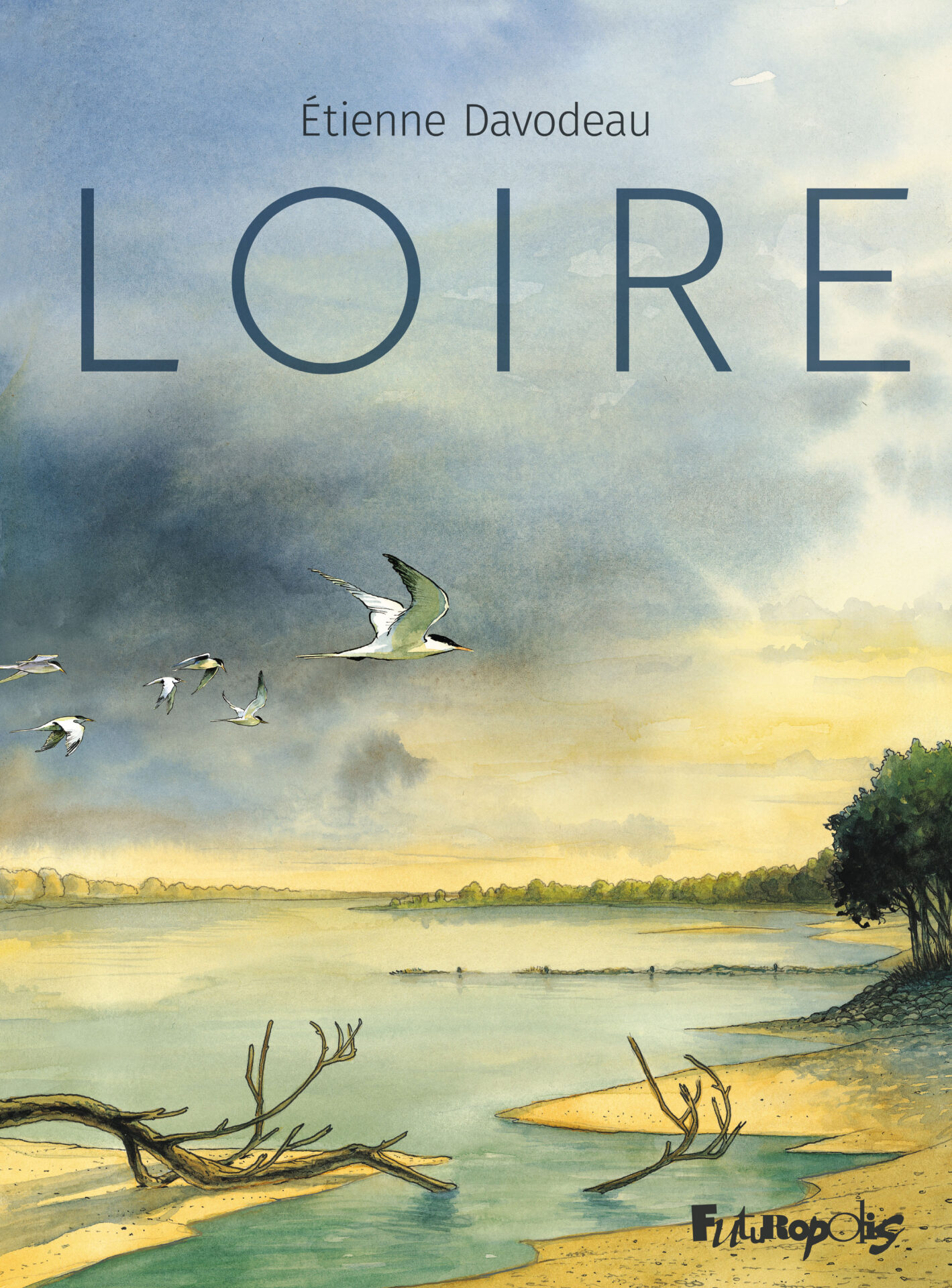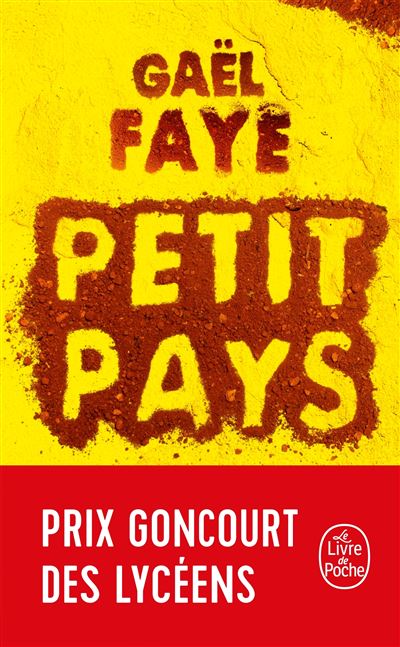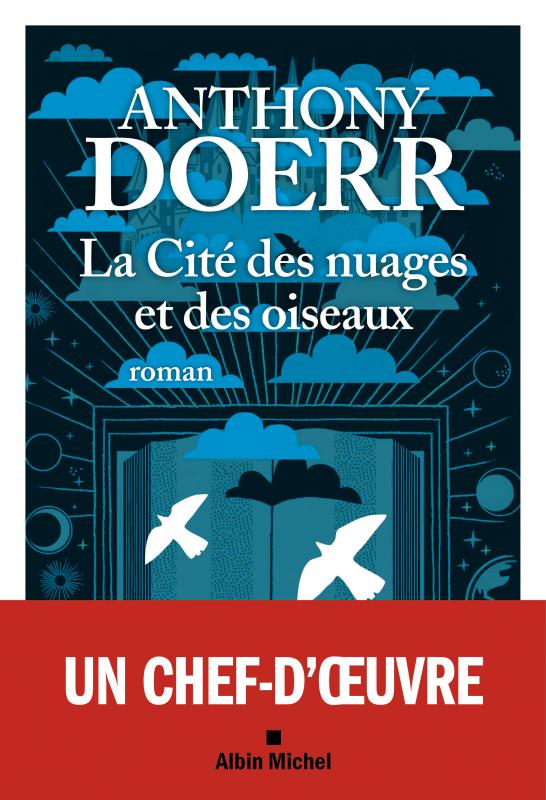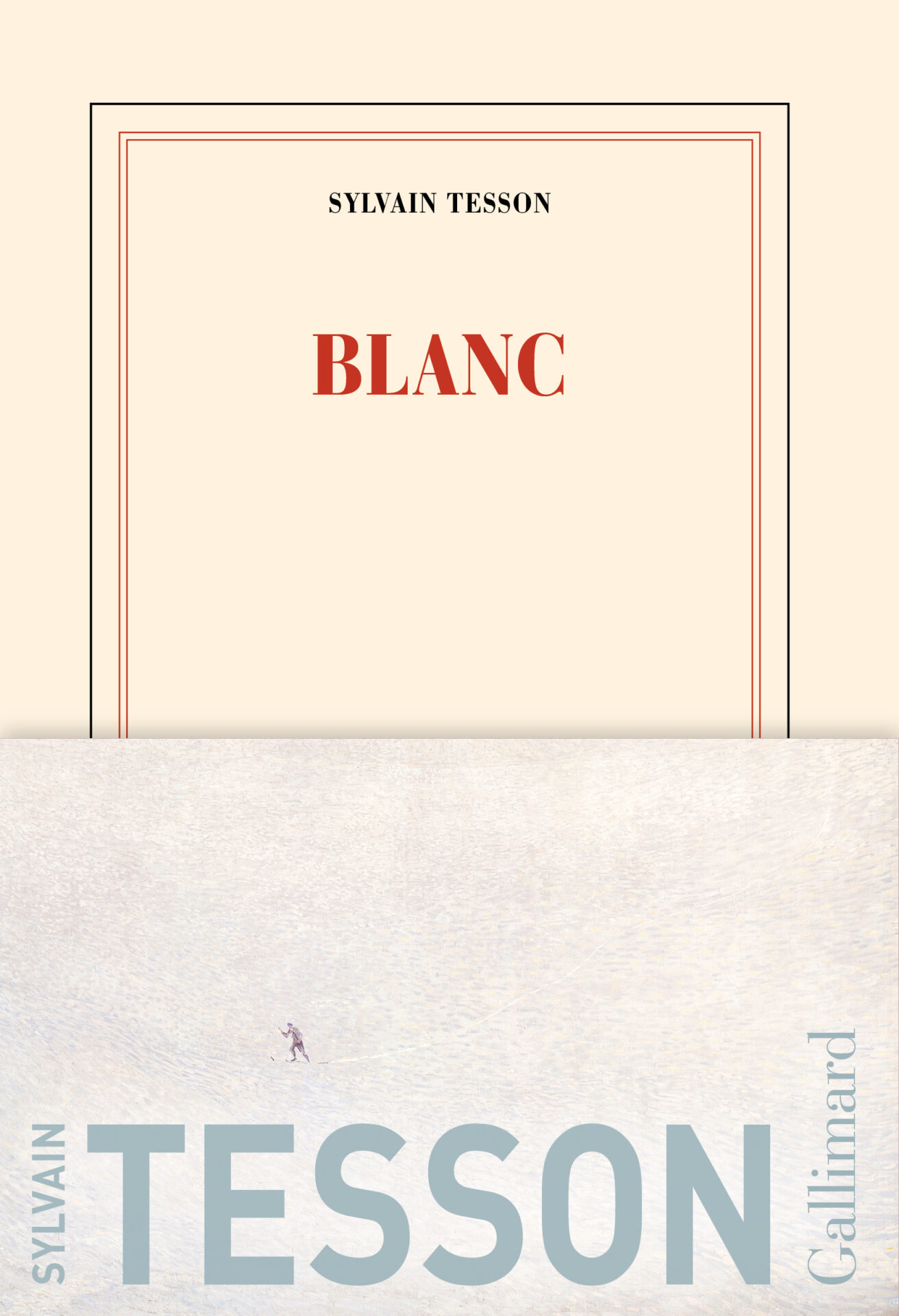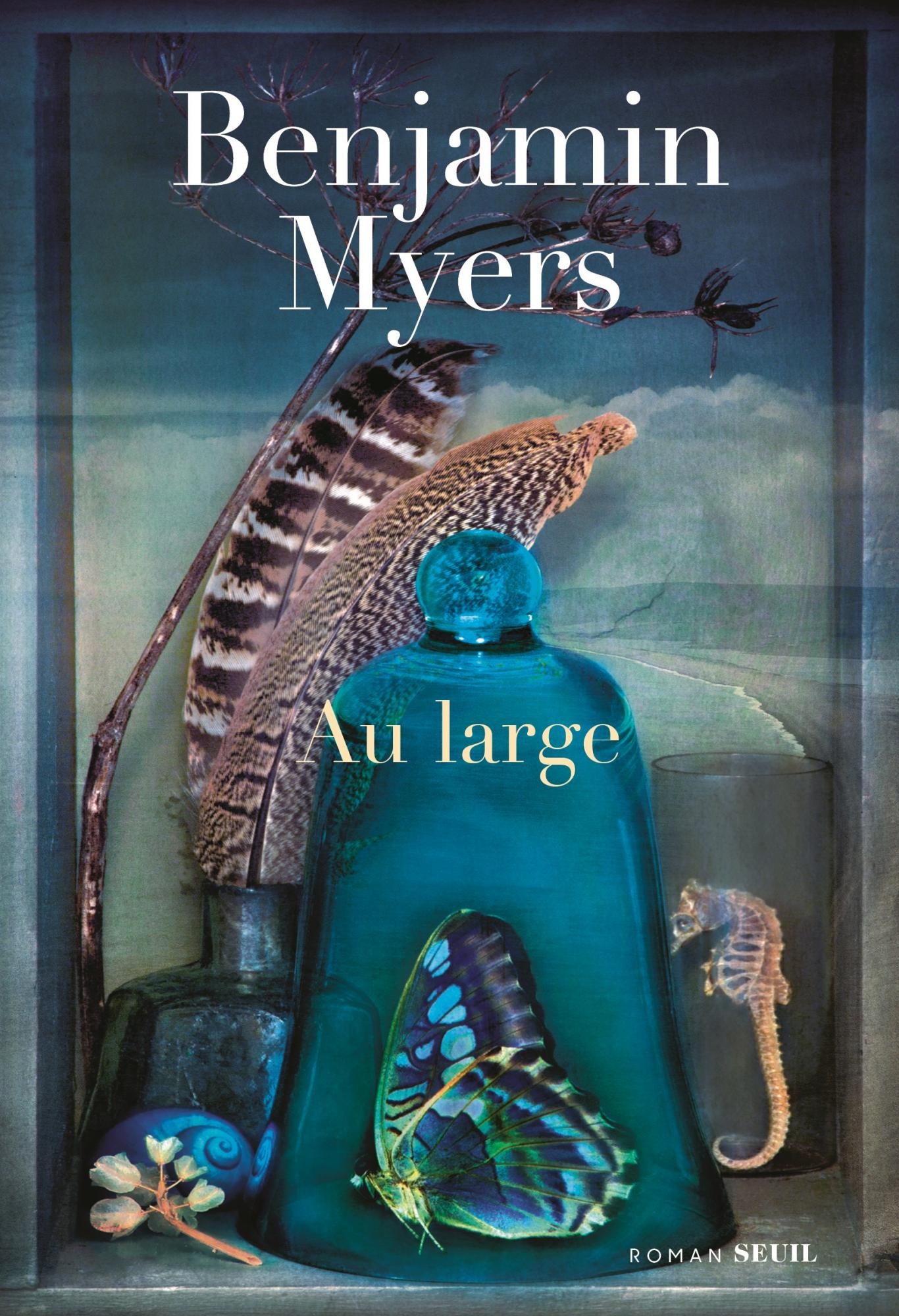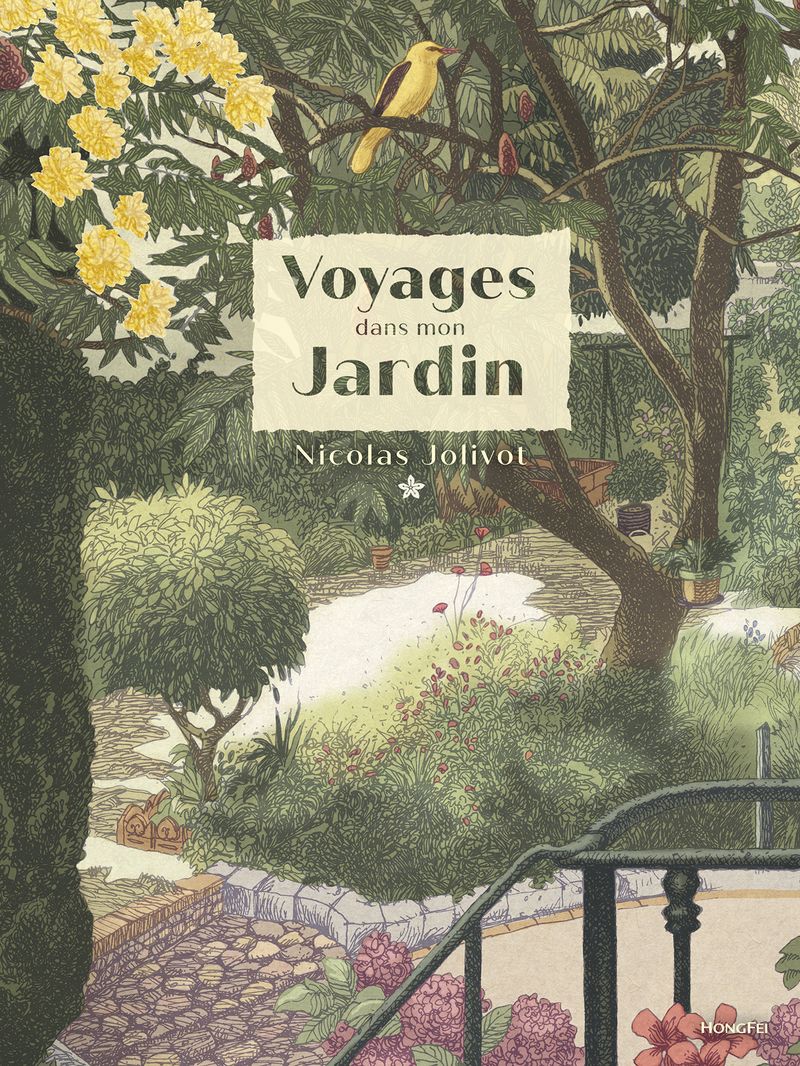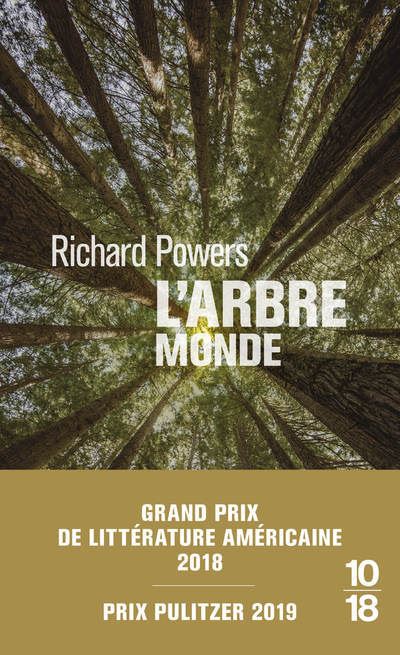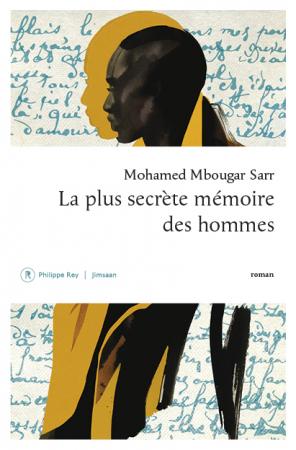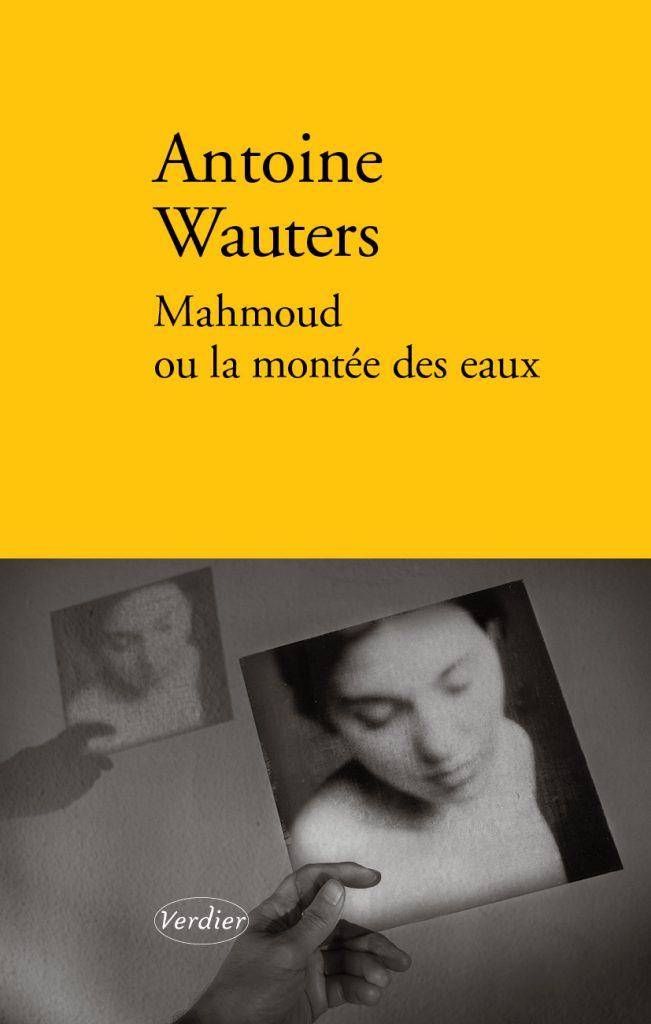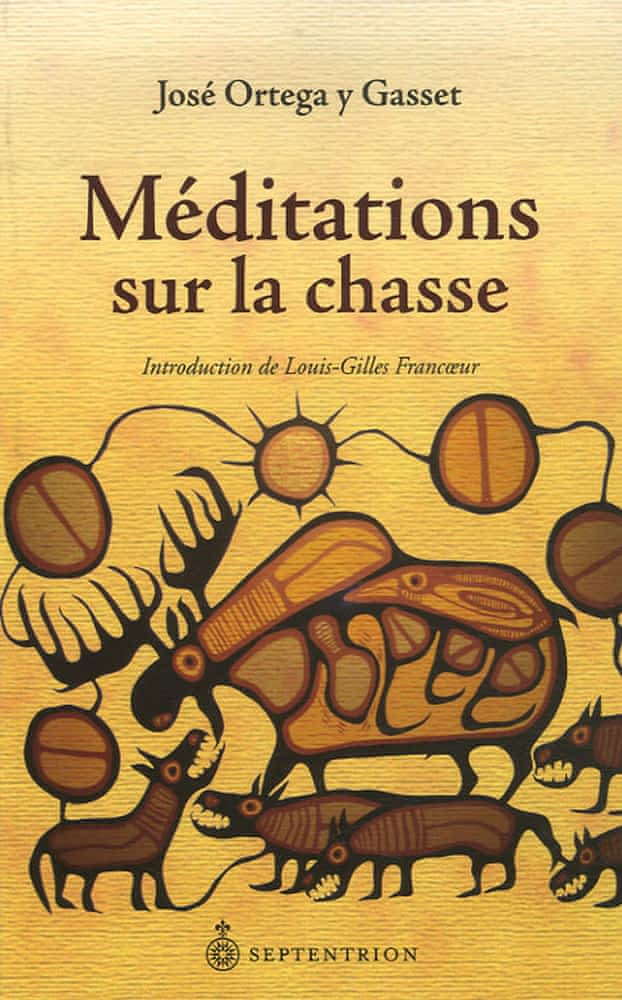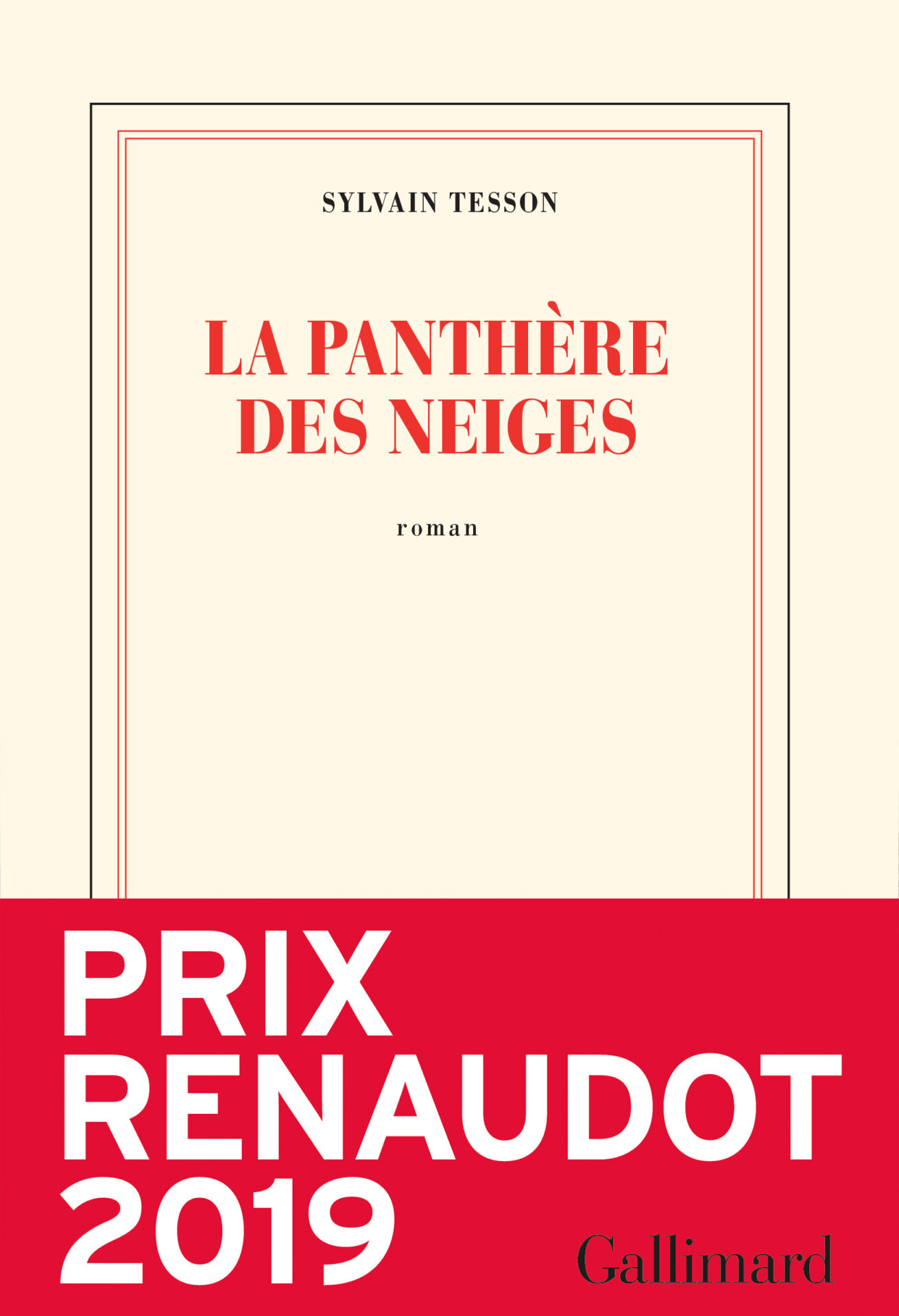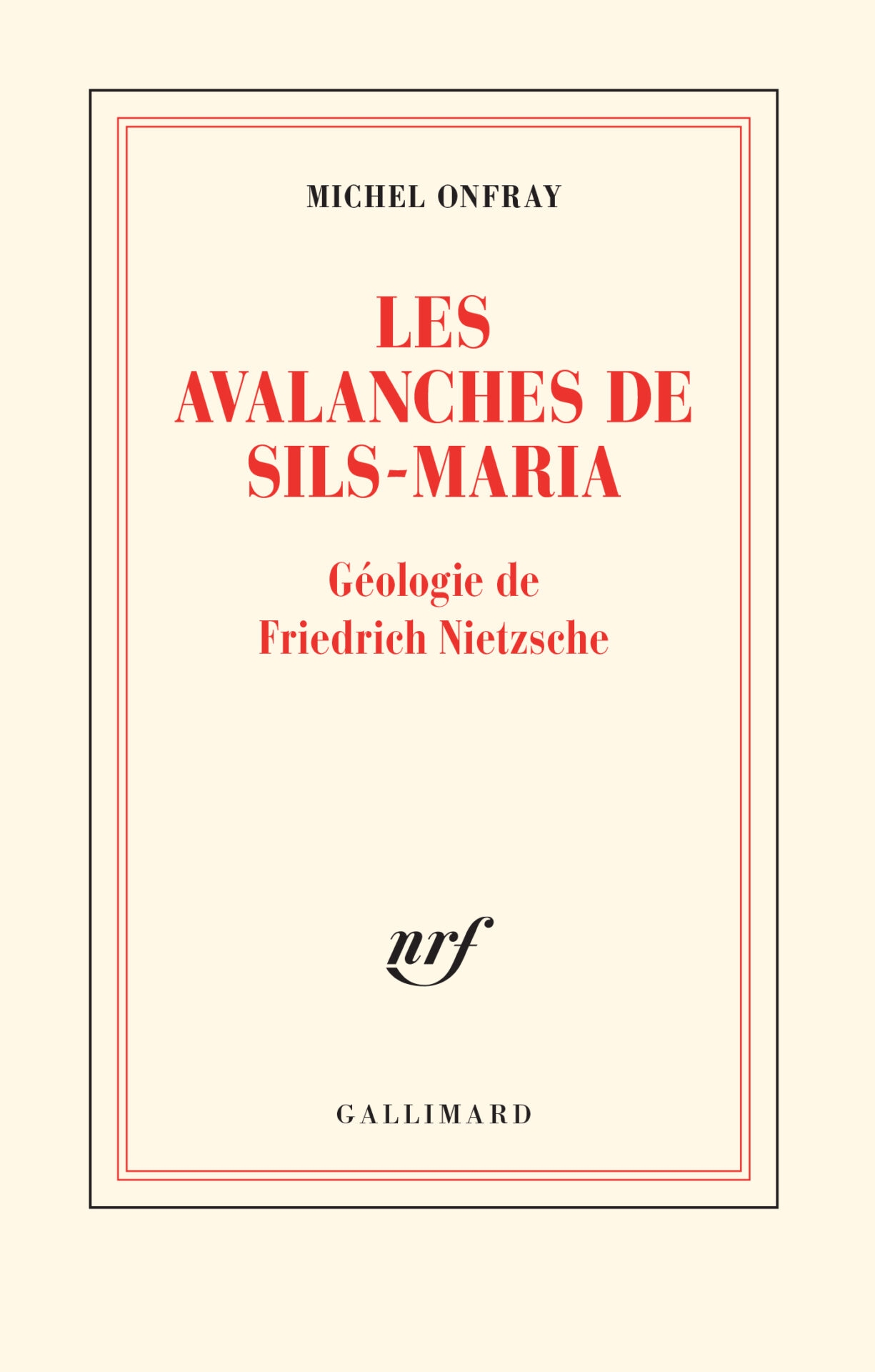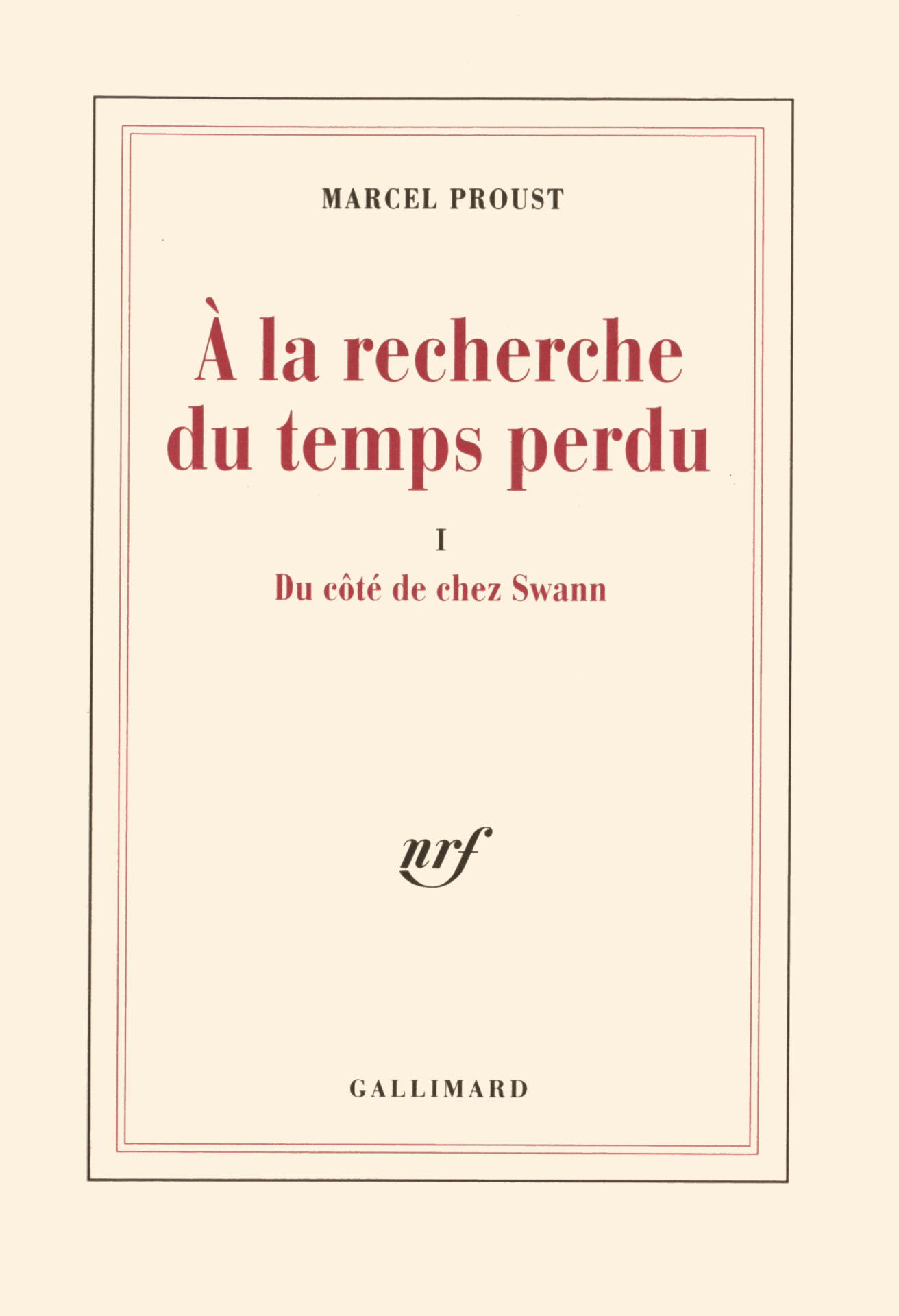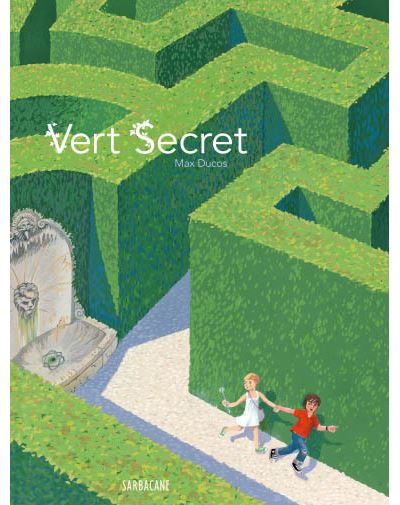Quelques livres à (re)lire
Cabane
Abel Quentin
Les Éditions de l’Observatoire, Paris, 2024.
Mars 2025 :
« – Vous avez passé cinquante ans à crier dans le désert…
– Oui. C’était couru d’avance. Il aurait fallu… quelque chose comme un effort surhumain et un renoncement collectif. Et, très vite, vous savez que l’effort surhumain n’arrivera jamais. Pourtant, les machines qui alimentent cette frénésie finiront bien par s’arrêter, lorsqu’elles seront à sec, faute de sève, faute de carburant. Je me souviens de ce que me disait Eugene. Un jour, il a écrit un texte qui faisait très… pasteur mormon. Les gens ne le savaient pas, mais Eugene avait un côté très lyrique, parfois. Une éloquence sacerdotale, qui lui faisait écrire des choses assez étonnantes. Après sa mort, j’ai imprimé ce texte, pour le garder toujours avec moi. Je me suis promis que je le déclamerais à quelqu’un, un jour.
Elle rit :
– Il voulait le crier au mégaphone, lors d’une manif devant le siège d’ExxonMobil, à Dallas.
Elle tira un petit papier de son portefeuille, qu’elle déplia. Elle lut d’un trait, d’une voix calme, en articulant chaque mot :
– « Les Machines s’arrêteront brutalement, après un ultime toussotement. L’angoisse sera là, et les gens lèveront la tête et il se fera un grand silence, mais le silence sera celui qui précède les grands meurtres. Alors l’humanité subira les conséquences de la façon la plus brutale qui soit. L’humanité sera sevrée trop brutalement des Machines et de la sève des machines, sans préparation. Elle ne mourra pas mais il y aura une grande clameur, et les gens se jetteront les uns contre les autres et se disputeront les flaques noires et suceront les ressources à la paille, un couteau à la main, en jetant des regards fous aux alentours. Les Machines enfin silencieuses, démantelées, inutiles, trop tardivement démantelées car le sol aura été asséché, il n’y aura plus rien à tirer de la terre, et les grandes catastrophes auront lieu. »
Elle replia le papier.
– Mon Eugene ! Bon, les catastrophes dont il parlait auront déjà commencé un peu avant… Près de la moitié de la population mondiale vit dans des zones qui sont directement menacées par le changement climatique. (pp. 433-434).
Éloge du mariage, de l’engagement et autres folies
Christiane Singer
Albin Michel, Paris, 2000.
Février 2025 :
« Le jardinier ne peut monter la garde contre les mulots, les chenilles, les taupes. Il ne peut pas guette chaque puceron, chaque bactérie. Il ne peut pas arrêter le vent d’ouest ni dissuader la tempête de se déchaîner. Il ne peut pas interdire à la grêle de s’abattre. Il ne peut pas non plus contraindre la plante à pousser plus vite en lui tirant les feuilles – ni vouloir la garder petite.
Il ne peut que « tenter de mettre toutes les chances du côté de la plante » et garder vivant avec elle un dialogue.
Ainsi pour la relation qui nous unit.
Je ne peux pas abolir ton destin, ni t’éviter épreuves et difficultés, ni enrayer tes échecs, ni provoquer ta réussite, ni entraver tes rencontres. Impossible de prendre les commandes de ta vie, de m’immiscer entre toi et ta peau, de glisser mon doigt entre ton écorce et ton aubier. Je ne peux que t’assurer de ma loyauté – ne jamais laisser tarir le dialogue entre nous, le raviver de neuf chaque jour. Mieux encore : je ne peux que respecter l’espace dont tu as besoin pour grandir. Te mettre à l’abri de ma trop grande sollicitude, de tout envahissement de ces rhizomes souterrains que les discrètes et indiscrètes manipulations de l’amour. » (p.88).
Ethnographies des mondes à venir
Philippe Descola et Alessandro Pignocchi
Seuil, collection « Anthropocène », Paris, 2022.
Le 31 janvier 2025 :
« Alessandro : […] les liens affectifs que l’on a noués avec un territoire, l’ensemble des usages qu’on y a développés au fil du temps, l’écheveau de liens sociaux qui se sont cousus petit à petit entre les humains et avec les non-humains sont irremplaçables. [Qu’] ils ne peuvent en aucune façon, aussi sophistiquée soit-elle, être réduits à une valeur marchande et entrer dans la sphère des échanges économiques.
Ce principe d’incommensurabilité des valeurs peut d’ailleurs tout à fait cohabiter avec l’usage de l’argent.
Philippe : Ce n’est pas la monnaie en soi qui porte la menace de la commensurabilité des valeurs, ce n’est même pas la monnaie employée comme moyen de convertir des biens d’un certain genre en biens d’un autre genre […] ; c’est le fait, comme le dit Marx, de se servir de l’échange de marchandises pour vendre plus cher qu’on a acheté : au lieu que l’argent serve d’intermédiaire pour convertir les produits agricoles que vend le paysan afin de se procurer les outils ou le mobilier dont il a besoin, l’accumulation d’argent dans le capitalisme marchand devient la fin en soi et les marchandises qui circulent ne sont que le moyen de faire un profit. » (pp.105-106).
Les guerriers de l’hiver
Olivier Norek
Michel Lafon, Paris, 2024.
Les gens qui rêvent
Guillaume Martin-Guyonnet
Grasset, Paris, 2024.
Le 13 janvier 2025 :
« Au travers d’épisodes comme celui de Tignes, j’ai réalisé à quel point je pouvais être autocentré, voire irrespectueux à l’égard de l’extérieur, des autres et de l’environnement – parce que j’étais tout simplement fonceur, ambitieux, passionné.
Les exigences du sport de haut niveau impliquent un mode de vie qui n’est pas forcément compatible avec certaines valeurs. J’ai déjà évoqué l’ampleur de mon bilan carbone et mon inconfort par rapport à celui-ci. Au-delà, c’est le principe même du sport qu’il me semble intéressant de questionner. Un exemple : comme à peu près tous les athlètes, il m’est arrivé d’effectuer une partie de ma préparation, hivernale notamment, dans une salle de musculation, à pousser ou hisser des poids dans le vide, dans un espace surchauffé, afin de me renforcer musculairement. Peut-on imaginer la quantité d’électricité qui pourrait être générée par tous ces mouvements effectués chaque jour aux quatre coins du monde par des sportifs occasionnels ou réguliers, et qui s’évapore dans le néant ? Le sport est une forme de débauche, qui ne peut apparaître que dans une société en trop-plein, où l’on a perdu tout rapport direct aux considérations matérielles. Partant de ce constat, et souhaitant éviter d’être totalement « hors sol », j’avoue au risque de surprendre qu’en guise de préparation physique générale, l’hiver, je préfère désormais réaliser des corvées de bois ou enfoncer quelques piquets à l’aide d’une masse pour fabriquer une clôture, plutôt que m’enfermer dans une salle où l’on reproduit artificiellement les mouvements physiques naturellement exigés par une vie en extérieur ; cela me semble moins vain. » (pp.139-140).
Mémoires d’une jeune fille rangée
Simone De Beauvoir
Gallimard, coll. « Blanche », Paris, 1958.
Le 23 décembre 2024 :
« […] en causant avec Sartre, j’entrevis la richesse de ce qu’il appelait sa « théorie de la contingence », où se trouvaient déjà en germe ses idées sur l’être, l’existence, la nécessité, la liberté. J’eus l’évidence qu’il écrirait un jour une oeuvre philosophique qui compterait. Seulement il ne se facilitait pas la tâche, car il n’avait pas l’intention de composer, selon les règles traditionnelles, un traité théorique. Il aimait autant Stendhal que Spinoza et se refusait à séparer la philosophie de la littérature. À ses yeux, la Contingence n’était pas une notion abstraite, mais une dimensions réelle du monde : il fallait utiliser toutes les ressources de l’art pour rendre sensible au coeur cette secrète « faiblesse » qu’il apercevait dans l’homme et dans les choses. La tentative était à l’époque très insolite ; impossible de s’inspirer d’aucune mode, d’aucun modèle : autant la pensée de Sartre m’avait frappée par sa maturité, autant je fus déconcertée par la gaucherie des essais où il s’exprimait ; afin de la présenter dans sa vérité singulière, il recourait au mythe. […] Il se rendait compte de cette maladresse, mais il ne s’en inquiétait pas ; de toute façon aucune réussite n’eût suffi à fonder sa confiance inconsidérée dans l’avenir. Il savait ce qu’il voulait faire et il avait la vie devant lui : sa santé, sa bonne humeur suppléaient à toutes les preuves. Manifestement sa certitude recouvrait une résolution si radicale qu’un jour ou l’autre, d’une manière ou d’une autre, elle porterait des fruits.
C’était la première fois de ma vie que je me sentais intellectuellement dominée par quelqu’un. […] Sartre, tous les jours, toute la journée, je me mesurais à lui et dans nos discussions, je ne faisais pas le poids. Au Luxembourg, un matin, près de la fontaine Médicis, je lui exposai cette morale pluraliste que je m’étais fabriquée pour justifier les gens que j’aimais mais à qui je n’aurais pas voulu ressembler : il la mit en pièces. J’y tenais, parce qu’elle m’autorisait à prendre mon coeur pour arbitre du bien et du mal ; je me débattis pendant trois heures. Je dus reconnaître ma défaite ; en outre, je m’étais aperçue, au cours de la conversation, que beaucoup de mes opinions ne reposaient que sur des partis pris, de la mauvaise foi ou de l’étourderie, que mes raisonnements boitaient, que mes idées étaient confuses. « Je ne suis plus sûre de ce que je pense, ni même de penser », notai-je désarçonnée. Je n’y mettais aucun amour propre. J’étais beaucoup plus curieuse qu’impérieuse, j’aimais mieux apprendre que briller. Mais tout de même, après tant d’années d’arrogante solitude, c’était un sérieux évènement de découvrir que je n’étais ni l’unique, ni la première : une parmi d’autres, et soudain incertaine de ses véritables capacités. Car Sartre n’était pas le seul qui m’obligeât à la modestie : Nizan, Aron, Politzer avaient sur moi une avance considérable. J’avais préparé le concours à la va-vite : leur culture était plus solide que la mienne, ils étaient au courant d’un tas de nouveautés que j’ignorais, ils avaient l’habitude de la discussion ; surtout, je manquais de méthode et de perspectives ; l’univers intellectuel était pour moi un vaste fatras où je me dirigeais à tâtons ; eux, leur recherche était, du moins en gros, orientée. […] tous avaient tiré beaucoup plus radicalement que moi les conséquences de l’inexistence de Dieu et ramené la philosophie du ciel sur terre. Ce qui m’en imposait aussi c’est qu’ils avaient une idée assez précise des livres qu’ils voulaient écrire. Moi j’avais rabâché que « je dirais tout » ; c’était trop et trop peu. Je découvris avec inquiétude que le roman pose mille problèmes que j’avais pas soupçonnés.
Je ne me décourageai pas pourtant ; l’avenir me semblait soudain plus difficile que je ne l’avais escompté mais il était aussi plus réel et plus sûr ; au lieu d’informes possibilités, je voyais s’ouvrir devant moi un champ clairement défini, avec ses problèmes, ses tâches, ses matériaux, ses instruments, ses résistances. Je ne me demandais plus : que faire ? Il y avait tout à faire ; tout ce qu’autrefois j’avais souhaité faire : combattre l’erreur, trouver la vérité, la dire, éclairer le monde, peut-être même aider à le changer. Il me faudrait du temps, des efforts pour tenir, ne fût-ce qu’une partie des promesses que je m’étais faites : mais cela ne m’effrayait pas. Rien n’était gagné : tout restait possible.
Et puis, une grande chance venait de m’être donnée : en face de cet avenir, brusquement je n’étais plus seule. Jusqu’alors les hommes à qui j’avais tenu – Jacques, et à un moindre degré Herbaud – étaient d’une autre espèce que moi : désinvoltes, fuyants, un peu incohérents, marqués par une sorte de grâce funeste ; impossible de communiquer avec eux sans réserve. Sartre répondait exactement au voeu de mes quinze ans : il était le double en qui je retrouvais, portées à l’incandescence, toutes mes manies. Avec lui, je pourrais toujours tout partager. Quand je le quittai au début d’août, je savais que plus jamais il ne sortirait de ma vie. » (pp.342-344)
3. Une aspiration au dehors (Éloge de l’amitié)
Geoffroy de Lagasnerie
Flammarion, coll. « Nouvel avenir », Paris, 2023.
22 décembre 2024 :
« L’amitié comme communauté de vie et de lecture, comme lieu de discussion et de soutien est l’une des rares formes sociales qui peut fonctionner, de manière pratique, comme un contre-pouvoir par rapport aux pouvoirs qu’exercent les différents champs, leurs modes de socialisation, leurs injonctions tacites ou explicites. Comment, sinon, prendre une distance avec les espaces institués de la production culturelle – avec « son » champ ? Où trouver des soutiens, comment nouer des liens si le geste créatif se fonde sur une rupture avec le nomos du champ ? En fonctionnant comme un lieu d’assistance et d’aide mutuelle, de protection, d’encouragement, l’amitié fonctionne là encore comme une production libératrice d’un dehors – c’est un hors-champ. » (p.182)
« Aucun domaine de l’existence n’échappe à la force libératrice de l’amitié. L’invention relationnelle est une pratique dotée d’une puissance sociale et intime. Elle ouvre un espace de conquête possible par rapport aux si nombreuses limitations, privations, restrictions que chacun de nous rencontre au cours de sa vie et qui peuvent la rendre si misérable, si monotone. Le poids et l’inertie des forces institutionnelles, des cadres traditionnels de la socialisation, des fonctions et des identités sont immenses, qui uniformisent les biographies et les aspirations, les manières d’être et de se penser, et surtout créent tant de regrets chez tant de gens… Seule l’action de mécanismes parallèles, implicites, secrets peut parfois, en surgissant, en enrayer la logique et, qui sait, nous donner un peu de liberté. » (p.189).
« Si le pouvoir de l’amitié est lié à l’idée d’une vie qui invente ses propres plateformes, qui, grâce aux supports fournis par l’entraide interne à un petit groupe, parvient à contrevenir aux modes d’existence institués, quelle leçon peut-on tirer quant au fonctionnement général de l’ordre social ? » (p.191).
« Quel discours, quelle épistémè, sont susceptibles d’offrir un lieu à l’amitié – d’en soutenir théoriquement la puissance existentielle ? C’est à partir de la sociologie, c’est-à-dire de la sociologie de Pierre Bourdieu, que l’on peut, me semble-t-il, forger les instruments qui permettent de saisir comment la force déstabilisatrice de la création relationnelle s’ancre dans des logiques d’ordre quasi métaphysique […] L’enjeu essentiel de l’existence humaine consiste à être arraché à la contingence et à la gratuité, à trouver des raisons d’exister, des justifications de soi. C’est ce qui explique la place centrale qu’occupent, dans le monde social, les rites d’institution, ces moments solennels qui ont pour but de faire croire à certains individus désignés qu’ils sont justifiés d’exister* : c’est la collation des grades ou des titres, l’adoubement du chevalier, la nomination à des charges ou des honneurs, […], etc. Ces actes magiques ont tous la même finalité : garantir une identité sociale ; ils signifient à quelqu’un ce qu’il est et ce qu’il doit être pour les autres ; ils le distinguent et l’arrachent à l’insignifiance en lui assurant le sentiment d’importer, d’être fondé à être quelque chose plutôt que rien. » (pp. 193-194).
* Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001, p.186.
«[…] à travers ou, mieux, par l’intermédiaire de toutes ces formes de capitaux, ce qui est recherché, c’est le capital symbolique, c’est-à-dire la reconnaissance, le sentiment d’exister et de compter. Les capitaux agissent comme capital symbolique, comme signes et comme signes d’importance. La vie sociale apparaît comme une « concurrence pour l’existence connue et reconnue ». « Misère de l’homme sans mission ni consécration », affirme Bourdieu dans sa Leçon sur la leçon* […]. » (p. 196).
* Pierre Bourdieu, Leçon sur la leçon, Paris, Minuit, 1980, p. 52.
« […] peut-être le plus important enseignement de Bourdieu réside-t-il dans le fait qu’il ne se contente pas de montrer que : qui dit reconnaissance dit mystification. Qui dit reconnaissance dit aussi, et nécessairement, relégation. La malédiction qui pèse sur le monde social est la nature essentiellement diacritique, différentielle, distinctive du pouvoir symbolique.
[…] tant que l’on reconnaît aux institutions le pouvoir de nous reconnaître et que l’on cherche à trouver en elles des justifications d’exister, on stabilise un système excluant qui implique une impossibilité de sortir de la malédiction de l’Être et du Néant, de la vie symbolique des uns qui engendre la mort symbolique des autres. L’angoisse de la mort et la nécessité métaphysique d’échapper à l’absurdité de l’existence constituent les ressorts fondamentaux de notre propension à collaborer avec un système où nous ne pouvons pourtant être et persévérer dans nos identités qu’à travers des processus d’exclusion et de relégation des autres et nous semblons donc condamnés à une forme d’impureté, de tristesse et de mauvaiseté. » (pp. 198-199).
« […] c’est cette quête d’une autre conception de la vie qui explique le recours permanent que Bourdieu fait, dans son oeuvre, au concept d’autonomie. Être autonome constitue en effet une autre façon d’échapper à la contingence, à l’arbitraire et à l’absurdité. […] Être autonome, c’est échapper à la dialectique aliénante de la reconnaissance, c’est s’affranchir de l’emprise qu’exercent sur les esprits les institutions et les consécrations officielles. » (p.200)
« […] Et c’est précisément à cet endroit que l’amour et l’amitié trouvent leur place. Ces pratiques sont invention d’une relationnalité autonome. » (p.201)
« L’amitié porte en elle l’idée d’une vie au-delà de la reconnaissance. Elle est le nom d’une pratique de soi qui prend la forme d’une politique de l’affirmation, d’une morale nietzschéenne de l’action, de l’actif, opposée au ressentiment et au réactif que ne peut pas manquer d’engendrer l’obsession de la reconnaissance et le fait de se juger soi-même en fonction du jugement des autres, constitué comme jugement dernier. Et c’est à ce jugement auquel, à chaque instant, nous essayons d’échapper, avec Didier et Édouard*, à travers notre relation et ce qu’elle produit. » (p. 203).
* Didier Eribon et Édouard Louis, d’où le titre « 3 ».
La Troisième Voie du vivant
Olivier Hamant
Odile Jacob, Paris, 2022.
« Le vivant nous offre la preuve de la possibilité d’une forme d’adaptabilité aux fluctuations environnementales sur le temps très long. Nous arrivons donc à la question centrale de cet essai : quelles solutions les organismes vivants ont-ils développées pour réussir à se maintenir et se développer dans un environnement fluctuant ?
Une réponse tient dans la définition de la sous-optimalité en biologie. Les organismes vivants sont localement sous-optimaux : ils utilisent des réactions, des enzymes, des processus de façon non optimale, notamment parce que ces acteurs sont souvent redondants, relativement inefficients, hétérogènes, aléatoires ou incohérents. Et pourtant l’intégration de l’ensemble de ces défauts, du moins du point de vue de l’être humain du XXIe siècle, construit des systèmes biologiques adaptables. En d’autres termes, la vie est construite sur l’absence d’optima locaux.
On pourrait donc définir la sous-optimalité comme la faculté d’évoluer sur le temps long en utilisant les faiblesses internes, non pas comme des problèmes à contourner, mais comme des ressorts permettant l’adaptabilité. Réciproquement, et étant donné la présence de ces faiblesses internes, la sous-optimalité implique que le système ne fonctionne pas au maximum de ses capacités. Il s’agit donc bien d’une inversion de paradigme : alors que l’optimisation fragilise, la sous-optimalité utilise les fragilités pour construire de la robustesse. […]
L’art japonais du kintsugi (lié au wabi-sabi, la philosophie de l’imperfection) pourrait illustrer ce point paradoxal : en soulignant les brisures de la céramique par des joints dorés, l’objet devient plus beau encore, par ses fêlures locales et son histoire magnifiée. Dit autrement, la sous-optimalité acte que la vie est en fait une survie : les organismes vivants sont constamment soumis à des contraintes, et plutôt que de vivre au maximum des capacités théoriquement possibles, le vivant vie en dessous de ses capacités, pour rester adaptable. Il est sous-optimal. Comme le dit Michel Serres, les faiblesses apparentes deviennent des forces : « Pour qu’[un système] s’adapte aux changements, il faut le concevoir et le construire […] muni de jeux, comme on dit de rouages qu’ils ont du jeu, c’est-à-dire des faiblesses. Toute évolution ne naît que des fragilités*. » (pp.111-112).
(* Serres, M. Le Contrat naturel, Paris, Éditions F. Bourin, 1990).
« Nous avons constaté que les organismes vivants sont construits sur l’aléatoire – une faiblesse pour l’humain du XXIe siècle obsédé par le contrôle – et que cette faiblesse est contrecarrée par la redondance, un autre défaut dans une société de l’hyper-performance. De même, la forme des organes émerge d’un conflit entre variabilité spatiale et variabilité temporelle de la croissance cellulaire. Dès lors il semble que l’incohérence soit une valeur transversale dans la sous-optimalité : non seulement les organismes vivants se construisent sur des « contre-performances », mais en plus, ils développent de nouvelles propriétés en les opposant. Finalement, les organismes vivants utilisent les conflits pour créer un équilibre, et donc une forme d’autonomie, au cours de leur développement. Dit autrement, l’autonomie émerge des incohérences et des contradictions, et la résilience émerge de l’autonomie. » (p.155).
(Voir aussi le passage sur l’agroécologie, pp.185-190 ; le passage sur le revenu universel, pp. 195-200 et le passage sur la décentralisation – le local, le village, pp. 206-212)
« La sous-optimalité met en scène le conflit entre confort individuel et résilience commune. Elle questionne donc la vague actuelle d’hyperoptimisation individuelle par personnalisation des services et des produits via le marketing, le numérique ou l’intelligence artificielle. Cette hyperoptimisation est-elle défaillante ?
Les effets négatifs de l’hyperpersonnalisation sont en fait très répandus, et se manifestent particulièrement bien avec la révolution numérique. Ainsi, outre les biais de Google Flu pour les épidémies, les intelligences artificielles décodant le langage sont en général sexistes et racistes, simplement parce que ce biais existe dans ce que les humains écrivent en ligne. L’hyperpersonnalisation est surtout une promotion de la communication sans garde-fou. L’exemple des krachs éclair à la Bourse, induits par des algorithmes plus rapides que les cerveaux humains, devraient être pris pour ce qu’ils sont : la bande-annonce d’un monde futur qui serait soumis à une suroptimisation généralisée. » (pp.212-213).
« La sous-optimalité, comme réponse à la surexploitation des ressources dans le Capitalocène, pourrait évoquer la théorie de la décroissance. Encore une fois, il s’agit d’un concept qui souffre d’une définition polysémique. Voici celle que je discute ici : l’objectif affiché de la décroissance est de faire émerger une société de la sobriété via la réduction de l’utilisation de matière et d’énergie. La décroissance concernerait d’abord les économies les plus gourmandes (c’est-à-dire les pays de l’OCDE), et se focaliserait sur les secteurs économiques écologiquement critiquables et peu bénéfiques socialement (plastiques à usage unique, SUV, marketing, etc.). La décroissance, c’est « moins mais mieux ».
Au-delà du lien à la sobriété, en quoi la décroissance pourrait-elle faire écho à la sous-optimalité ? En lisant (trop) vite, la décroissance pourrait ressembler à une récession imposée d’en haut, produisant des résultats sur le plan écologique, mais à un coût socio-économique difficilement supportable. En fait, la décroissance correspond à un changement de paradigme plus systémique. Il s’agirait de construire une économie qui ne requiert plus la croissance pour exister. On parle d’ailleurs de post croissance pour éviter cette confusion.
Dans ce scénario, l’accent ne porterait plus sur la performance, mais sur des indicateurs de développement et de bien-être humain, respectueux de la planète. La décroissance n’est d’ailleurs qu’une déclinaison principalement européenne d’un mouvement nettement plus large et plus ancien à l’échelle planétaire. Citons notamment le Buen Vivir (« bien vivre ») de l’Amérique latine, le Swaraj (l’ « émancipation ») en Inde ou le plus récent Tang Ping (littéralement « rester allongé » et popularisé sous l’expression lying flat) en Chine. » (pp. 220-221).
« Encore une fois, l’espace des possibles peut s’ouvrir, non pas en exploitant les ressources éperdument, mais en profitant des interactions entre habitants de la Terre, dans une société coexistant dans et avec les écosystèmes. Il s’agit d’ailleurs d’une inversion plus large des mentalités. Nous utilisions la matière pour gagner du temps (par exemple, du kérosène pour prendre l’avion) ? À l’avenir, dans la bio-économie circulaire sobre, nous allons plutôt utiliser le temps pour préserver la matière. Dans l’agriculture dite conventionnelle, nous exploitons les écosystèmes pour augmenter la productivité des cultures ? Avec l’essor de l’agroécologie, notre production agricole va nourrir les écosystèmes. Nous vivions dans la société de la croissance basée sur des pénuries artificielles ? Nous allons construire une société sobre basée sur l’abondance et la complexité des interactions. Finalement, en misant sur un progrès reposant sur la robustesse, et non sur la performance, la sous-optimalité du vivant nous pousse à questionner profondément nos modèles socio-économiques et nos organisations. » (p. 225).
Dans l’ombre
Edouard Philippe, Gilles Boyer
Livres de Poche, Paris, 2012.
Il neige sur le pianiste
Claudie Hunzinger
Grasset, Paris, 2024.
Le Livre de Daniel
Cris de Stoop
Editions Globe, Paris, 2023.
« De retour dans notre ferme, où je tente d’écrire cette histoire de vie et de mort, je repense aux deux Daniel de Saint-Léger qui menaient des vies si différentes, l’un auréolé de gloire et de succès, l’autre considéré comme un raté. On trouve partout des photos du premier, tandis que je n’ai pas pu en dénicher une seule du second datant des vingt dernières années de son existence retirée.
Je reste des minutes, des heures, presque la journée entière, à contempler un vieux cerisier derrière ma fenêtre, sur lequel j’ai fixé une mangeoire que je remplis régulièrement de graines. Des mésanges, des pinsons et parfois un rouge-gorge s’empressent de venir les picorer, tandis que les poules se promènent au milieu du lierre, en dessous, et que le coq roux leur montre en criant une graine de tournesol tombée à terre. Quant au chat tricolore, il se frotte la tête contre le tronc de l’arbre. Je ne me lève qu’une seule fois, pour chasser un geai en quête d’une proie.
Rester ainsi à observer toute cette activité me met presque en transe. Qui ne connaît de tels moments où la vie semble s’arrêter, que ce soit en regardant le paysage qui défile par la fenêtre du train, en laissant son esprit vagabonder pendant une promenade matinale, ou en écoutant le chant d’un merle perché au sommet d’un arbre ? Ce ne sont pas des moments perdus, mais des moments précieux, même s’ils ne durent que l’espace de quelques battements de coeur, on a alors le pur sentiment d’exister.
[…]
Est-ce interdit de se soustraire à la vie sociale ? Beaucoup y voient, apparemment, de la suffisance, un rejet de la société, une façon de cracher sur son prochain qu’on cherche à fuir comme la peste. Le lien avec les gens qui nous entourent est important, de même que l’aspiration à faire partie d’un groupe, la force d’être ensemble. Mais il existe aussi un attachement vertical, entre les différentes générations, entre les vivants et les morts, que Daniel ressentait profondément. Nous ne sommes ni les premiers ni les derniers.
Cela m’a toujours fasciné. Ces gens qui ne jouent plus le jeu, qui se retirent, se détournent de la société, suivent leur propre chemin et nagent à contre-courant, il m’arrive de les envier. Se soustraire au système est une preuve de courage, je pense. » (pp.182-184).
« Pour ma part, je ne regrette pas le monde des médias que j’ai laissé derrière moi afin de m’isoler dans la ferme familiale pour écrire. C’est un travail solitaire, qui demande calme et silence. Je me surprends à moins me préoccuper de l’actualité et à regarder de plus en plus souvent la mangeoire à oiseaux.
Cela me paraît presque une hérésie à notre époque numérique, où on doit constamment se tenir informé, être accessible sur les réseaux sociaux et partager sa vie avec la planète entière d’un simple clic. Comment peut-on encore disparaître aujourd’hui ? Il faudrait pour cela débrancher toutes nos webcams pour ne pas être espionnés dans notre propre maison, nos déplacements sont traçables à tout moment par nos portables et nos GPS, des caméras nous surveillent presque partout dans l’espace public, il semble toujours y avoir quelqu’un qui regarde par-dessus notre épaule.
En réaction, certains goûtent de nouveau la tranquillité de l’invisibilité. Voir, sans être vu. Comme les enfants qui jouent à cache-cache, comme les animaux qui se camouflent pour passer inaperçus.
La nature aime le secret. La vérité se déploie sous la surface. Ce qui est essentiel n’a pas toujours besoin d’être remarqué.
Oncle Daniel, qui ne faisait qu’un avec sa ferme et acceptait son déclin, avait pour philosophie de toujours se tenir en dehors. Il ne nourrissait plus d’ambitions, n’attendait plus rien. Dans sa ferme, derrière ses volets fermés et sa porte barricadée, personne ne pouvait le voir ni l’entendre, il pouvait être simplement lui-même. Libre.
Tu savais où tu en étais avec toi-même.
C’est ainsi, en tout cas, que je vois les choses pour le moment, alors que, hypnotisé par les mésanges et les poules, je pense à oncle Daniel.
Son isolement volontaire lui a toutefois coûté la vie. » (pp.185-187).
« L’idée qu’il faut venger le mal par le mal est encore présente dans notre culture, mais la justice pénale ne suffit pas dans ce cas. « Ils sortiront probablement de prison plus mauvais qu’ils n’y sont entrés. La plupart des détenus récidivent. »
La justice restauration a l’immense avantage que coupables et victimes se considèrent de nouveau comme des personnes, sans menace ni diabolisation. « C’est un processus de “réhumanisation“. Il existe aujourd’hui des services de médiation officiels pour mener à bien ce processus. On essaie de parvenir à un accord ensemble. » (p.266).
Du même bois
Marion Fayolle
Gallimard, Paris, 2024.
« Le visage de la mémé est patiné par le vent et le soleil, ses hanches rembourrées par le fromage et la bonne viande de la ferme. Le paysage déborde sur elle, elle n’aurait pas pu vivre ailleurs. Elle a la même silhouette que le prunier du jardin, celui qui croule sous trop de fruits, qui s’affaisse sous le poids de sa générosité. Ses bras, son dos, ses jambes sont fatigués d’avoir passé toute une vie à donner. Elle en a élevé, des gamins : les siens et ceux des autres.
Pendant des années, elle a pris soin des bêtes et de la terre sans jamais faire de manières.
Quand elle reçoit, pour le café, des amies de la ville, elle trouve qu’elles sont bien mises, qu’à côté elle ne ressemble à rien. Pourtant c’est tout l’inverse. Leurs beaux souliers, leurs lèvres trop rouges, leurs fanfreluches autour du cou, leurs breloques aux poignets font ressortir la beauté de la mémé. Sa vieillesse ne fait pas diversion, elle se montre sans mentir et démasque toute les autres. Elle, elle ne cherche pas à rester jeune, elle sait qu’au bout d’un moment la vie tue. Tant qu’elle peut encore habiter dans sa ferme, se débrouiller pour le quotidien, elle dit qu’elle voudrait bien durer encore un peu. Le pépé avait davantage peur de mourir, c’est sûrement pour ça qu’il a eu besoin de perdre la tête, pour perdre la peur aussi. Elle, elle n’a aucune crainte, elle a déjà dépassé l’âge de ses parents, elle a bien vécu ; elle ne regrette rien et ne reviendrait pas en arrière.
Tous les jours, quel que soit le temps, elle part faire un petit tour pour aérer sa tête et entretenir son âge. Elle se traîne jusqu’au bout du potager, c’est déjà bien. » (pp.105-106)
Jacaranda
Gaël Faye
Grasset, Paris, 2024.
Plouhéran
Isabel Del Real
Delcourt, coll. Encrages, Paris, 2024.
Le Poids des secrets
Aki Shimazaki
Actes Sud, coll. « Babel Les Coffrets », Arles, 2021.
Coffret contenant les cinq volumes du « Poids des secrets » : « Tsubaki », « Hamaguri », « Tsubame », « Wasurenagusa », « Hotaru ».
Veiller sur elle
Jean-Baptiste Andrea
L’Iconoclaste, Paris, 2023.
« Je dois tout à mon père, à notre côtoiement trop court sur cette boule de magma. On me soupçonna parfois d’indifférence, parce que je parlais peu de lui. On me reprocha de l’avoir oublié. Oublié ? Mon père vécut dans chacun de mes gestes. Jusqu’à ma dernière oeuvre, jusqu’à mon dernier coup. Je lui dois ma hardiesse de ciseau. Il m’apprit à tenir compte de la position finale d’une oeuvre, puisque ses proportions dépendaient du regard que l’on poserait sur elle, de face ou levé, et à quelle hauteur. Et la lumière. Michelangelo Buonarroti avait poncé sa Pietà à n’en plus finir pour accrocher le moindre éclat, sachant qu’elle serait exposée dans un lieu sombre. Enfin, je dois à mon père l’un des meilleurs conseils que j’aie jamais reçus :
– Imagine ton oeuvre terminée qui prend vie. Que va-t-elle faire ? Tu dois imaginer ce qui se passera dans la seconde qui suit le moment que tu figes, et le suggérer. Une sculpture est une annonciation. » (p. 229)
« Sculpture, c’est très simple. C’est juste enlever des couches d’histoires, d’anecdotes, celles qui sont inutiles, jusqu’à atteindre l’histoire qui nous concerne tous, toi et moi et cette ville et le pays entier, l’histoire qu’on ne peut plus réduire sans l’endommager. Et c’est là qu’il faut arrêter de frapper. » (p.574)
« Il faut avoir vu les peintures de Fra Angelico à la lueur des éclairs… » (p.579)
Des diables et des saints
Jean-Baptiste Andrea
L’Iconoclaste, Paris, 2021.
Promenons-nous dans les bois
Bill Bryson
Petite Biblio Payot, Paris, 2013.
Au coeur de l’hiver
Jean-Marc Rochette
Les Étages Éditions, 2024.
Une vocation
Marc Pirlet
Murmure des Soirs, 2023.
« J’appartiens à la communauté des lecteurs qui ne recherchent pas, ou en tout cas pas seulement, un divertissement ou une évasion dans les livres mais une compréhension du monde et même, bien plus encore – mais je parle ici au passé car j’ai fini par me guérir de cette illusion -, le sens de la vie. Dotés d’une forme supérieure de sensibilité, les écrivains perçoivent ce que nous ne percevons pas, ou alors confusément, et par la maîtrise qu’ils ont de la langue, ils parviennent à nous la faire partager, élargissant ainsi le champ de notre conscience. Depuis bientôt cinquante ans, je n’ai de cesse de glaner les petits cailloux blancs qu’ils laissent derrière eux pour nous amener à des vérités à côté desquelles, sans leur clairvoyance, nous serions passés en les ignorant. » (p.73).
Créer son jardin résilient
Didier Willery
Editions Ulmer, 2024.
Martin Eden
Jack London
Gallimard, Folio Classique, 2016.
Traduction et édition de Philippe Jaworski.
« Ils enfourchèrent leur bicyclette par un après-midi de la fin de juin, et partirent dans les collines. C’était la deuxième fois qu’il allait en excursion seule avec elle, et tandis qu’ils roulaient dans l’air tiède et parfumé, plaisamment rafraîchi par la brise marine, il fut profondément ému de voir que le monde était si beau et si bien ordonné, qu’il faisait bon y vivre et y aimer. Ils laissèrent leur bicyclette au bord de la route et montèrent au sommet d’un tertre brun où l’herbe brûlée par le soleil exhalait les senteurs douces et sèches de la moisson, et un sentiment de bien-être.
« Elle a fait son travail », dit Martin alors qu’ils s’asseyaient elle sur la veste du jeune homme, lui allongé tout contre la terre chaude. Il respirait l’odeur tendre de l’herbe fauve qui, pénétrant dans son cerveau, faisait s’agiter ses pensées du particulier à l’universel. « Elle a accompli ce qui est sa raison d’être », poursuivit-il en tapotant affectueusement l’herbe sèche. « L’ambitieuse s’est hâtée de pousser sous les mornes averses de l’hiver dernier, puis elle a fleuri, attiré les insectes et les abeilles, dispersé ses semences, s’est conformée aux impératifs de sa mission et du monde, et … »
Elle l’interrompit : « Pourquoi regardez-vous toujours les choses sous un angle aussi terriblement prosaïque ?
– Parce que j’étudie l’évolution, j’imagine. À vrai dire, je ne regarde avec mes yeux à moi que depuis peu de temps.
– Mais il me semble que votre prosaïsme vous empêche de voir la beauté ; vous détruisez la beauté comme ces garçons qui, en attrapant les papillons, font disparaître la poudre leurs magnifiques ailes. »
Il secoua la tête.
« La beauté a un sens, mais auparavant je l’ignorais. Je me contentais d’accepter la beauté comme une chose dénuée de sens ; elle était simplement là, sans rime ni raison. Je ne connaissais rien à la beauté. À présent je sais, ou plutôt je commence à savoir. Cette herbe est plus belle pour moi maintenant que je sais pourquoi elle est une herbe, et quelle chimie du soleil, de la pluie et de la terre l’a fait devenir ce qu’elle est. La vie d’un brin d’herbe est un vrai roman, savez-vous, et même un roman d’aventures. J’en palpite rien que d’y penser. Lorsque je songe au jeu de l’énergie et de la matière, et au formidable combat qu’elles se livrent, j’ai l’impression que je pourrais écrire une épopée sur l’herbe. » (pp. 181-183).
Verts
Patrick Lacan et Marion Besançon
Editions Rue de Sèvres, 2024.
Urushi
Aki Shimazaki
Actes Sud, 2024.
Urushi clôture le quatrième cycle romanesque d’Aki Shimazaki, Une clochette sans battant, une pentalogie dont les quatre premiers romans sont Suzuran (2020), Sémi (2021), No-No-Yuri (2022) et Niré (2023).
Le Chant du chardonneret
Carine Mestdage
Murmure des soirs, 2024.
Le 11 mai 2024 :
« Déjà ! Viens voir, Saku.
À mi-hauteur du mur neuf, sur la gauche, quelques petites étoiles roses frémissent entre deux pierres.
– L’herbe à Robert ! Elle est déjà là à s’enraciner. Ah ! Saku, je te l’ai promis ! Va chercher une bouteille de ton bon rosé, et je te raconterai ce qui me lie à cette jolie sauvageonne, hé !
Assis dans l’herbe à côté de Louis, le dos bien calé contre le mur, Sakutarô lève son verre, le fait tourner entre ses doigts, y observe les jeux de lumière et attend. Louis boit un peu, toussote, aspire une nouvelle gorgée.
– Ah ! Saku ! Depuis le temps que tu me vois travailler le plus souvent torse nu, tu as bien remarqué cette cicatrice sur ma hanche gauche. […] Une chute de quatre mètres, plusieurs fractures du bassin et du fémur, des mois sans pouvoir poser le pied à terre. Pour un garçon turbulent comme je l’étais… Voilà…
Long silence.
– Devoirs à domicile, lectures. Je crois avoir lu tout le rayon « jeunesse » de la bibliothèque municipale, Alexandre Dumas, Jules Vernes, Alain-Fournier, tout y est passé. Même si cela me permettait de rêver un peu je sombrais peu à peu dans la déprime.
Louis vide son verre et, saisissant la bouteille, le remplit aussitôt.
– Un jour de beau temps, pensant bien faire, ma mère a installé ma chaise longue sur le perron pour que je puisse voir mon frère et nos amis jouer au ballon. Tu imagines ! Spectacle insupportable ! Alors j’ai détourné les yeux et regardé obstinément le mur qui longe l’escalier. Plusieurs touffes roses de géranium Robert y fleurissaient. Je me souvenais pourtant avoir vu ma mère, une dizaine de jours plus tôt, occupée avec un petit couteau à débarrasser les pierres des mousses et des herbes. Ainsi la vie, même arrachée, renaissait, s’épanouissait ! Ce fut le déclic. Je me suis mis à faire sérieusement les exercices physiques prescrites, quelques semaines plus tard je marchais et retournais à l’école.
– Belle histoire Louis ! C’est ainsi que tu es devenu jardinier ?
– Oh ! Pas tout de suite. Poussé par mes parents et mon goût de la lecture, j’ai d’abord fait des études d’instituteur. J’ai aimé ce métier cinq ans, puis l’appel, le goût du « baiser de la terre » a été le plus fort.
– Le bonheur, enfin !
– Bonheur, qu’est-ce que cela veut dire ! Non ! La vie, avec ses naissances, ses morts, ses joies, ses peines. La vie, simplement. Se laisser caresser, agripper par le monde, et, le temps qui file, le faire chanter quand il vous glisse entre les doigts. C’est tout ! Tu comprends, Saku ?
Comprendre ? Le regard perdu dans le vague, Sakutarô sourit, écoute les paroles de Louis, leur musique mêlée au chant des criquets, à quelques beuglements lointains, au gazouillis des hirondelles volant en piqué au-dessus de la cour, au crissement près de son front des feuilles du tilleul parcheminées par la sécheresse. » (pp.92-94.)
De Grandes Espérances
Charles Dickens
Nouvelle traduction par Jean-Jacques Greif, Tristram, 2022.
Goldman
Ivan Jablonka
Editions du Seuil, « La Librairie du XXIe siècle », 2023.
Le 3 avril 2024 :
« Jean-Jacques Goldman n’a jamais varié de cette ligne sociale-démocrate, mais si l’on regarde de plus près, à travers ses chansons et ses interviews, on constate qu’il a été profondément influencé par les conceptions marxistes en vigueur dans sa famille (le contraire eût été surprenant) :
– c’est la vie socio-économique qui détermine la conscience des individus, et ce matérialisme historique nourri de sciences sociales révèle le conditionnement de nos choix, alors que nous croyons agir en toute liberté ;
– un des grands maux de la société est le « fétichisme de la marchandise », avec ses objets, ses marques, ses modes, ses spectacles, tout ce qui est vain et secondaire ;
– malgré le capitalisme qui voudrait réduire nos vies à des quantités, des chiffres et des profits, il y a des choses qui ne s’achètent pas, comme la liberté ou l’amitié, et l’on est riche de ça ;
– il faut lutter contre toutes les formes d’aliénation, celle du travail en usine, celle de la société de consommation, mais aussi celle de l’industrie culturelle (au sens d’Adorno et Horkheimer), responsable par exemple du matraquage d’un tube à la radio ;
– l’oppression subie par autrui nous touche personnellement et nous oblige à résister ensemble, au-delà de nos appartenance ethno culturelles ;
– l’émancipation des individus dans une société d’égaux est l’objectif ultime, selon les principes de justice et de fraternité.
Comme Albert Goldman a fui les appareils pour préserver les idéaux de sa jeunesse, Jean-Jacques retranche du marxisme la violence, la dictature du prolétariat, la destruction de l’état bourgeois, au profit d’une pensée « rouge » dédiée au bonheur des hommes : travail et temps libre pour tous, instruction gratuite obligatoire, égalité des chances, fin des discriminations, disparition de la misère. Pendant leurs congés, les ouvriers iront voir la mer. » (p.49).
La Vie secrète des arbres
Peter Wohlleben
Editions Les Arènes, 2017.
Le 11 mars 2024 :
«Leur bien-être dépend de la communauté : si les plus faibles disparaissent, tous y perdent. » (p.41).
Thomas et le Voyageur
Gilles Clément
Editions Albin Michel, 2011.
Le 16 décembre 2023 :
«Notre jardin, celui des hommes en quête de savoir, n’est pas un lieu de l’épuisement des sciences, un objet observé à distance, c’est un système sans limite de vie, sans frontière et sans appartenance, nourri au rêve des jardiniers et sans cesse remodelé par les conditions changeantes de la nature. C’est un lieu de sauvegarde des réalités tangibles et intangibles. Un territoire mental d’espérance. » (p.226).
Les quatre saisons de Gilles Clément
Itinéraire d’un jardinier planétaire
Frédérique Basset
Les éditions Rue de l’échiquier, l’écopoche, 2022.
Le 29 novembre 2023 :
« Observer le vagabondage des plantes, les graines qui ont germé là où la terre et la lumière leur ont offert le meilleur, s’émouvoir de la résilience des coquelicots, nivelles, bleuets, digitales et molènes… Et puis redessiner le chemin. À la Vallée, Gilles vit au rythme de son jardin. Un temps qui s’écoule loin des horloges. « Quand on jardine, on est avec le monde et en dehors d’un certain monde, loin de l’agitation convenue, des rendez-vous, des agendas. Aujourd’hui, tout doit se faire dans l’instant ! Et l’on croit que c’est important. Alors que dans le rapport au temps du jardin, on n’est jamais agacé si quelque chose n’est pas instantané. Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité. À la Vallée, la question du temps n’est pas celle de la rentabilité. Elle est dans le temps qu’il fait, le temps qui passe ou ne passe pas, mais qui est celui qui doit être, sans plus. Si j’ai tant besoin de cet endroit, c’est bien parce que je n’y suis pas martyrisé par le temps. »
Alors le jardinier peut rêver : ses mains sont occupées, mais son esprit est libre. « Le jardinier partage cet état avec les artisans. Pendant qu’il travaille, l’esprit voyage, fabrique son rêve, ses fantasmes. Je n’ai jamais vu d’artisans malheureux et je ne me souviens pas d’avoir été malheureux en jardinant, ou alors c’étaient des périodes où j’étais déprimé, ce qui m’est arrivé deux ou trois fois dans ma vie. Sans que j’en sois conscient, le jardin a eu pour moi un rôle thérapeutique quand j’étais enfant. »» (p. 80).
Le jardin en mouvement
Gilles Clément
Sens Et Tonka Editeurs, 2017
Le 29 novembre 2023 :
« IV. Friche
Friche, mot dévalorisé.
On dit : « tomber en friche ».
Contradiction : lieu de vie extrême.
Voie d’accès au climax.
[…]
Presque toujours, le terme de friche s’applique à un terrain qui a cessé d’être travaillé ou qui pourrait l’être. On ne se sert pas de ce mot pour désigner les coteaux sauvages, les prairies abruptes de haute montagne, les arrière-dunes encombrées de chardons bleus ou tout autre milieu dit « naturel ». Non, la friche exclut à la fois la nature et l’agriculture, elle laisse entendre que l’on pourrait faire mieux.
Pourrait-on faire un jardin par hasard ? » (p. 56).
« V. Climax
Climax : niveau optimum de végétation.
Presque toujours, sous nos climats, le climax est une forêt. Si l’on abandonnait tous les sols cultivés de France, le territoire se recouvrirait d’un manteau forestier équivalent à celui qu’ont connu les hommes d’avant la Gaule. » (p.61).
« Le climax est tributaire des conditions de vie. Ces conditions de vie définissent les biotopes. Il y a autant de niveaux climaciques qu’il y a de biotopes – et ceux-ci peuvent se modifier dans le temps. Pour le jardin en mouvement, le climax est un point de mire, une visée possible. Il n’est pas nécessaire de l’atteindre.
En effet, la notion même de mouvement suppose une mobilité visible. Or, la mobilité des bouleversements climatiques n’est pas à l’échelle de temps d’un jardin, en particulier lorsque le climax est de type forestier. À titre d’exemple, il faut à peu près quarante ans pour qu’un sol de culture abandonné à lui-même se transforme en petit-bois de futaie. Ce n’est pas le cas de la friche. » (p.62)
« La friche, elle, est tout à fait à l’échelle de temps du jardin. Son développement naturel évolue de trois à quatorze ans après l’abandon d’un sol à lui-même. Mais on peut accélérer ce processus et « installer » la friche à son niveau de richesse floristique le plus intéressant – c’est-à-dire entre sept et quatorze ans, suivant les cas – de manière presque immédiate, de la même façon que l’on crée un jardin.
Cela est rendu possible par le fait que la friche est généralement riche de toutes les strates végétales, en particulier les strates herbacés et que celles-ci ont un temps d’apparition et de disparition très rapide… Il suffit de gérer ces temps pour reculer l’accès au climax.
Cependant, la connaissance du climax local donne une indication utile sur la série floristique finale dont le jardin est menacé. Comment l’harmoniser avec cette végétation future. Peut-on, d’ores et déjà, l’intégrer ? » (p. 64).
Le Comte de Monte-Cristo
Alexandre Dumas
Calmann-Levy, 1956 (édition en IV tomes).
Le 5 octobre 2023 :
« Quant à vous, Morrel, voici tout le secret de ma conduite envers vous : il n’y ni bonheur ni malheur en ce monde, il y a la comparaison d’un état à un autre, voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l’extrême infortune est apte à ressentir l’extrême félicité. Il faut avoir voulu mourrir, Maximilien, pour savoir combien il est bon de vivre. » (p. 1483-1484).
Loire
Etienne Davodeau
Futuropolis, 2023.
Epigraphes :
« Des forêts luxuriantes de l’Amazonie aux étendues glacées de l’Arctique canadien, certains peuples conçoivent donc leur insertion dans l’environnement d’une manière fort différente de la nôtre. Ils ne se pensent pas comme des collectifs sociaux gérant leurs relations à un écosystème, mais comme de simples composantes d’un ensemble plus vaste au sein duquel aucune discrimination véritable n’est établie entre humains et non-humains. »
Philippe DESCOLA, Par delà nature et culture, 2005.
« Nous avons vécu dans la fiction d’un roman moderne de séparation qui a mis la nature d’un côté et la culture de l’autre. Mais les choses – et la Loire parmi elles – n’ont jamais cessé de parler, n’ont jamais cessé d’être des causes, des âmes si vous voulez, des principes agissants, animés, qui font que le système Terre dans son ensemble vit, que la Loire parle et agit. »
Bruno LATOUR, devant la Commission du Parlement de Loire, Tours, le 19 octobre 2019.
Un voyage dans les jardins. Eloge de la terre
Byung-Chul Han
Actes Sud, 2023
16 mai 2023 :
« Le mot anglais digital se dit en français « numérique ». Le numérique démystifie, dépoétise, déromantise le monde. Il lui vole tout mystère, toute étrangeté, tout ce qu’il approche devient connu, banal, familier, se transforme en like, en identique. Tout devient comparable. Face à la numérisation du monde, il serait urgent de reromantiser la terre, de lui rendre sa poétique, de lui restituer la dignité du mystérieux, du beau, du sublime. » (p.25)
« Depuis que je travaille au jardin, j’ai un sentiment étrange, un sentiment que je ne connaissais pas auparavant et que je ressens physiquement. C’est sans doute un sentiment de la terre qui me rend heureux. Peut-être la terre est-elle un synonyme du bonheur qui de nos jours s’éloigne peu à peu de nous. Retour à la terre signifie par conséquent retour au bonheur. La terre est la source du bonheur. Mais aujourd’hui nous l’abandonnons, notamment dans le sillage de la numérisation du monde. Nous ne recevons plus la force de la terre, qui anime et qui rend heureux. Elle est réduite à la taille de l’écran. » (p. 28).
Petit Pays
Gaël Faye
Grasset, 2016
01 avril 2023 :
« …prends garde au froid, veille sur tes jardins secrets, deviens riche de tes lectures, de tes rencontres, de tes amours, n’oublie jamais d’où tu viens… » (page 214, Le Livre de Poche).
La Cité des nuages et des oiseaux
Anthony Doerr
Albin Michel, 2022
Blanc
Sylvain Tesson
Gallimard, 2022
Un chien à ma table
Claudie Hunzinger
Grasset, 2022
Manières d’être vivant
Baptiste Morizot
Actes Sud, 2020
21 août 2022 :
J’ai pu mettre à profit mes vacances d’été pour, enfin, lire le dernier livre de Baptiste Morizot, « Manières d’être vivant », paru chez Actes Sud en 2020, dans la collection « Mondes sauvages. Pour une nouvelle alliance ».
« Manières d’être vivant » est un recueil de plusieurs essais d’écologie-éthologie philosophiques.
C’est un livre formidable dans lequel Baptiste Morizot s’appuie sur des expériences de terrain, notamment sur la piste des loups dans les montagnes du Vercors en France, pour construire plusieurs concepts philosophiques très féconds, qui, je pense, pourraient bien servir à nourrir une politique locale positive, fédératrice, qui réponde aux multiples enjeux des crises que nous traversons.
Se basant notamment sur l’éthique de Spinoza qui nous incite à cultiver ce qu’il y a de meilleur en nous, pour notre propre bien, notre « santé », notre « joie » (il compare le « conatus » de Spinoza au « loup blanc » de la légende amérindienne cherokee), il démontre comment il nous faut sortir du libéralisme des « intérêts » et reprendre conscience de nos interdépendances avec les autres vivants et tout ce qui vit (y compris le sol), dans des « communautés d’importance » où les relations seraient basées sur le principe des « égards ajustés ». Il ne serait plus question d’opposer des camps (les tenants de la « Nature » contre les extractivistes par exemple, les défenseurs du loup contre les bergers, la passion contre la raison, etc.), mais, jouant les diplomates, d’acter et de démontrer nos interdépendances et l’impérieuse nécessité, quelque soit le point de vue de chacun, le camp d’origine (berger ou loup par exemple), de reconnaître que nous partageons des enjeux vitaux communs, notamment l’habitabilité de notre territoire, et « une vulnérabilité mutuelle » (p.270) face à ceux-ci.
Je souligne : « Dans une pensée écopolitique des interdépendances, le problème n’est plus de jouer l’indépendance contre la dépendance, c’est l’art de faire la différence entre les liens qui libèrent et les liens qui aliènent. » (p.274)
Au large
Benjamin Myers
Seuil, 2022
15 juin 2022 :
Un des plus beaux romans que j’ai lus ces dernières années !
Une ode à la nature, un roman d’initiation à la liberté, à la poésie et à l’intelligence.
Dans les paysages du Yorkshire juste après la Seconde Guerre mondiale.
De toute beauté.
Voyages dans mon jardin
Nicolas JOLIVOT
HongFei, 2021.
L’Arbre monde
Richard POWERS
Cherche midi, 2018
8 mai 2022 :
Certains romans sont comme des jardins, enclos, structurés autour d’un grand arbre central – le personnage principal – et de quelques autres sujets plus ou moins importants. Le narrateur jardinier trace quelques chemins aventureux ou poétiques. Il décrit les scènes, quelques parterres entretenus, le plus souvent par la main de l’homme, sinon par les machines, ou pire, avec quelques produits chimiques. Certains romans sont comme ces jardins et n’offrent qu’une vision très limitée, voire anthropocentrée, de l’homme sur la nature ; les évènements y sont réduits aux schémas et aux scénarios que l’homme est capable de projeter autour de lui. Mais la littérature peut davantage. Elle peut nous ouvrir à beaucoup plus grand, à beaucoup plus beau ; à l’immensité, à la complexité de la vie ; la nature, le sauvage. Elle peut nous en dire plus sur qui nous sommes véritablement, nous sujets humains, homo sapiens ; nous les « occupants » du monde, trop occupés à nous « développer », en oubliant de regarder, d’admirer et de préserver toute la beauté du reste du Vivant.
« L’Arbre monde » de Richard Powers n’est pas de ces romans-jardins. Il est un vaste roman-forêt ; un roman total où neuf personnages se voient décrits tels des arbres-sujets, avec leurs racines profondément ancrées, reliées, interconnectées ; leurs troncs et leurs cimes – la vie dans la canopée – et enfin leurs graines, capables de les transporter sur des distances insoupçonnées. Ces neufs personnages aux destins tellement différents tentent de survivre dans cette forêt-monde, menacée par la violence des hommes, par le capitalisme destructeur et le développement numérique porté par les licornes de la Silicon valley. Ils chercheront chacun refuge dans la lutte pour la sauvegarde de l’Arbre-monde. La violence du combat les confrontera à la mort d’un des leurs et aux risques que l’homme fait peser sur lui-même en s’attaquant de la sorte au Vivant.
Un livre qui nous remet « à l’endroit » du territoire « dont on vit », pour rependre une expression de Bruno Latour…
EXTRAITS :
« Personne ne voit les arbres. Nous voyons des fruits, nous voyons des noix, nous voyons du bois, nous voyons de l’ombre. Nous voyons des ornements ou les jolies couleurs de l’automne. Des obstacles qui bloquent la route ou qui obstruent la piste de ski. Des lieux sombres et menaçants qu’il faut défricher. Nous voyons des branches qui risquent de crever notre toit. Nous voyons une poule aux oeufs d’or. Mais les arbres… les arbres sont invisibles. » (p. 625).
« Ce monde n’est pas notre monde avec des arbres dedans. C’est un monde d’arbres, où les humains viennent tout juste d’arriver. […] Les arbres sont conscients de notre présence. La chimie de leurs racines et des parfums que dégagent leurs feuilles change à notre approche… Quand on se sent bien après une promenade en forêt, c’est peut-être que certaines espèces essaient de nous draguer, ou de nous soudoyer. Tant de remèdes miracles proviennent des arbres, et nous avons à peine gratté la surface de ce qu’ils ont à offrir. Les arbres essaient depuis longtemps d’entrer en contact avec nous. Mais ils parlent à des fréquences trop basses pour que les humaines les entendent. » (p.626).
« Le monde comptait six billions d’arbres quand les humains sont apparus. Il en reste la moitié. Dont la moitié aura encore disparu dans cent ans. Et ce que sont censés dire, selon pas mal de gens, tous ces arbres en voie de disparition, c’est ce qu’on leur fait dire. » (p. 637) « […] Autrefois, les arbres parlaient aux hommes tout le temps. Même les gens normaux les entendaient. » (p.637)
« Ces gens veulent des rêves de percée technologique. Une nouvelle méthode pour transformer la pulpe de peuplier en papier en consommant un tout petit peu moins d’hydrocarbures. Du bois de construction génétiquement modifié qui bâtira de meilleures maisons et arrachera les pauvres du monde entier à leur misère. La réparation qu’ils veulent, c’est simplement une démolition un peu moins coûteuse. Elle pourrait leur parler d’une machine très simple qui ne réclame aucun carburant et très peu de maintenance, qui conserve le carbone en permanence, enrichit l’humus, rafraîchit le sol, nettoie l’air, et s’adapte à toutes les tailles. Une technologie qui se duplique et répand même de la nourriture gratuite. Un engin si beau qu’il mérite des poèmes. Si les forêts étaient brevetables, elle aurait droit à une ovation. » (pp. 643-644).
« Si nous pouvions voir le vert, nous verrions une chose de plus en plus intéressante à mesure qu’on s’en approche. Si nous pouvions voir ce que fait le vert, nous ne serions jamais seuls ou blasés. Si on comprenait le vert, on pourrait apprendre à cultiver toute la nourriture dont nous avons besoin en trois couches d’épaisseur, donc sur un tiers des sols dont nous avons besoin actuellement, avec des plantes qui se protégeraient mutuellement des parasites et des tensions. Si nous savions ce que voulait le vert, nous n’aurions pas à choisir entre les intérêts de la Terre et les nôtres. Ils ne feraient qu’un ! […] Voir le vert, c’est saisir les intentions de la Terre. » (p. 671).
« Je me suis posé la question à laquelle vous me demandez de répondre. […] Quelle est LA meilleur chose qu’un humain puisse faire pour le monde de demain ? […] » (pp.672-673)
« Vous m’avez demandé comment réparer la maison. Mais c’est nous qui avons besoin d’être réparés. Les arbres gardent en mémoire ce que nous avons oublié. Chaque spéculation doit faire de la palace à une autre. Mourir, c’est aussi la vie. » (pp.685-686).
Graines.
« Disons que la planète naît à minuit et que sa vie court sur un jour.
Au début, il n’y a rien. Deux heures sont gaspillées par la lave et les météores. La vie n’apparaît pas avant trois ou quatre heures du matin. Et même alors, c’est seulement d’infimes bribes qui se dupliquent. De l’aube à la fin de la matinée – un milliard d’années de ramification – rien n’existe que de maigres cellules simples.
Et puis il y a tout. Quelque chose de fou arrive, peu après midi. Une variété de cellule simple en asservit deux ou trois autres. Les noyaux acquièrent des membranes. Les cellules développent des organelles. Un camping solitaire donne naissance à une ville.
Les deux tiers du jour sont passés quand animaux et plantes prennent des chemins séparés. Mais la vie n’est encore que cellules simples. Le crépuscule tombe avant que la vie composée s’impose. Tous les grands organismes vivants sont des retardataires qui n’arrivent qu’à la nuit. À neuf heures du soir apparaissent méduses et vers de terre. L’heure est presque écoulée quand survient la percée : épines dorsales, cartilage, une explosion de corps possibles. D’une minute à l’autre, d’innombrables tiges et branches nouvelles éclatent et s’égaillent dans la frondaison qui s’étend.
Les plantes parviennent à la terre juste avant vingt-deux heures. Puis les insectes, qui aussitôt décollent. Quelques minutes plus tard, les tétrapodes s’arrachent à la boue des marées, en charriant sur leur peau et dans leurs tripes des univers entiers de créatures plus anciennes. Vers onze heures, les dinosaures ont fait leur temps, et laissent la barre aux mammifères et aux oiseaux pour une heure.
Quelque part dans ces soixante minutes, très haut dans la canonnée phylogénétique, la vie se fait consciente. Des créatures commencent à spéculer. Des animaux apprennent à leurs enfants le passé et le futur. Des animaux apprennent à avoir des rituels.
L’homme moderne au sens anatomique se pointe quatre secondes avant minuit. Les premières peintures rupestres apparaissent trois secondes plus tard. Et en un millième de clic de la grande aiguille, la vie résout le mystère de l’ADN et se met à cartographier l’arbre de vie lui-même.
À minuit, la plus grande partie du globe est convertie en cultures intensives pour nourrir et protéger une seule espèce. Et c’est alors que l’arbre de vie devient encore autre chose. Que le tronc géant commence à vaciller. » (pp. 699-700).
« Il n’y a pas d’arbres isolés dans une forêt. […] Il n’y a plus de nature sauvage. La forêt a succombé à la sylviculture sous assistance chimique. Quatre milliards d’années d’évolution, et c’est comme ça que ça va finir. Politiquement, concrètement, émotionnellement, intellectuellement : les humains, c’est tout ce qui compte, c’est le dernier mot. On ne peut pas mettre un terme à l’appétit humain. On ne peut même pas le ralentir. Même la stabilité coûte trop cher pour l’espèce. » (p. 706).
Richard Powers, L’Arbre monde, Traduit de l’anglais (Etas-Unis) par Serge Chauvin, Cherche Midi, 2018.
La plus secrète mémoire des hommes
Mohamed MBOUGAR SARR
Philippe Rey, Paris, 2021
http://www.philippe-rey.fr/livre-La_plus_secrète_mémoire_des_hommes-504-1-1-0-1.html
La forêt-jardin
Créer une forêt comestible en permaculture pour retrouver autonomie et abondance
Martin CRAWFORD
Ulmer, Paris, 2017
https://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/la-foret-jardin-creer-une-foret-comestible-en-permaculture-pour-retrouver-autonomie-et-abondance-600-cl.htm
Mahmoud ou la montée des eaux
Antoine Wauters
Verdier, 2021
« Vieillir, c’est devenir l’enfant que plus personne ne voit.
Méditations sur la chasse
José Ortega y Gasset
Lisbonne, 1942, Traduit de l’espagnol par Charles-A.Drolet aux éditions Septentrion
12 octobre 2021
Vivre avec la terre
Perrine et Charles HERVÉ-GRUYER
Actes Sud, Arles, 2019
https://www.actes-sud.fr/vivre-avec-la-terre
1er août 2021,
Citation page 140 :
Les Anglos-Saxons ont récemment formulé un beau concept: rewilding, réensauvager des pans entiers de nos pays. L’emprise humaine sur la planète est devenue suffocante. Partout, la nature est étouffée par notre domination sans partage. La biodiversité s’érode à une vitesse sans précédent. Le concept permaculturel de zones autorise une évolution majeure : le fait de concentrer nos soins sur de petites zones extrêmement productives permet de libérer des espaces pour la vie sauvage. Sans perdre en productivité, bien au contraire, nous pourrions rendre à la nature des surfaces potentiellement vastes si cette approche se généralisait. Les services écosystémiques rendus par ces territoires sauvages permettront aux espaces soignés de gagner en productivité et en durabilité. On sort de la spirale de destruction de la biosphère pour entrer dans une spirale vertueuse de régénération. Il s’agit véritablement d’une manière inédite de concilier les besoins de l’humanité et ceux de la biosphère, et cette piste mérite d’être explorée comme l’une des plus prometteuses pour habiter durablement notre planète. »
Où suis-je ?
Leçons du confinement à l’usage des terrestres
Bruno LATOUR
Éditions La Découverte, Les Empêcheurs de penser en rond, Paris, 2021.
https://www.editionsladecouverte.fr/ou_suis_je_-9782359252019
Habiter en oiseau
Vinciane DESPRET
Actes Sud, Mondes sauvages, Arles, 2019
https://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/habiter-en-oiseau
La Panthère des neiges
Sylvain Tesson
Gallimard, Blanche, Paris, 2019.
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/La-panthere-des-neiges
Les avalanches de Sils-Maria.
Géologie de Frédéric Nietzsche
Michel ONFRAY
Gallimard, Blanche, Paris, 2019
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Les-avalanches-de-Sils-Maria
« […] les pierres enfin, elles aussi soumises à l’entropie, à la transformation, à la mutation, à la métamorphose, mais cette fois-ci plus proches encore des longues durées de l’éternel retour, en regard de cycles géologiques : ce qui anime l’éphémère qui meurt le soir du jour qui a vu sa naissance est semblable à ce qui anime la croûte terrestre : ces lacs géologiques un jour en fusion se sont durcis plus tard après pressions diverses et coulures singulières : quartz, gypses, schistes, granites disposent d’entités séparées parce qu’ils ont une généalogie, une enfance, une adolescence, un temps adulte et une scénescence différents… Du magma orange en fusion jadis sans oeil humain pour le voir à la poudre de sable dans laquelle scintille la lumière que je regarde dans mes mains au bord du lac, il y a le trajet d’une vie de pierre. »
Michel ONFRAY, « Les Avalanches de Sils-Maria. Géologie de Frédéric Nietzsche », Gallimard, 2019, page 46.
Dans les forêts de Sibérie
Sylvain TESSON
Gallimard, Blanche, Paris, 2010.
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Dans-les-forets-de-Siberie
À la recherche du temps perdu
I. Du Côté de ces Swann
Marcel PROUST
Gallimard, Blanche, Paris, 1917.
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Du-cote-de-chez-Swann